
Conférences par le frère Marc CHAUVEAU, dominicain, historien de l’art
Mardi 7 novembre 2023 de 15h à 17h : Nicolas de Staël
Couvent du Saint Nom, 93 rue Tête d’Or, Lyon 6

Conférences par le frère Marc CHAUVEAU, dominicain, historien de l’art
Mardi 7 novembre 2023 de 15h à 17h : Nicolas de Staël
Couvent du Saint Nom, 93 rue Tête d’Or, Lyon 6

V. Delecroix, Naufrage, Gallimard, Paris 2023
Vincent Delecroix est connu comme philosophe. Il a notamment travaillé la philosophie de la religion et Kierkegaard. Il a aussi publié quelques romans et essais ; son dialogue avec Philippe Forest, Le deuil. Entre le chagrin et le néant propose une réflexion tout à fait originale sur le refus de l’injonction à faire son deuil.
Est sorti en août dernier chez Gallimard un nouveau roman, Naufrage, dont le point de départ est un fait réel ; une embarcation de fortune chargée de vingt-neuf migrants sombre dans la Manche en novembre 2021. Une enquête est ouverte pour non-assistance à personnes en danger à l’encontre d’une militaire du Centre de surveillance et de secours. L’enregistrement des conversations avec le jeune qui appelle à l’aide conserve quelques phrases plus glaçantes que l’eau mortelle : « Tu n’entends pas. Tu ne seras pas sauvé. » et peu avant « Je ne vous ai pas demandé de partir en mer. »
On aurait pu craindre un texte de la bonne conscience, une sorte de leçon de morale, celle que la gendarme instructrice voudrait imposer au cours de l’enquête. Mais la fiction mène ailleurs, dans un long monologue de la militaire incriminée qui essaie de comprendre ce qu’elle a dit et sa responsabilité. Au trois quarts du récit, une pause dans ce dialogue avec elle-même fait effraction, racontant la tentative de traversée jusqu’à la noyade.
Le fait divers disparaît au profit d’une sorte de méditation, au sens de Descartes, une recherche de la vérité, du sens de ce que nous vivons, de ce qui est vraiment. Deux questions s’entremêlent et nous laissent, comme les dialogues de Platon, sans réponse, mais moins coupablement naïfs, moins ignorants de nous-mêmes : la question du mal et de la responsabilité, personnelle ou collective, politique et sociale, la question du salut puisque « tu ne seras pas sauvé ».
Le salut est-il possible et que signifie-t-il ? De la salutation (« Salut ! ») au secours reçu, on pourra lire une parabole d’une délivrance du mal et de la mort, ici et maintenant, l’exigence d’une justice qui viendrait enfin reconnaître tous ceux que leurs semblables ne peuvent pas, ne veulent pas voir. C’est aussi la militaire incriminée qui cherche à savoir ce qu’est sa vie, la valeur de sa vie, le salut pour elle aussi. L’auteur ne dit rien d’une dimension théologale du salut, même si perce ici où là un cri, venu du fond des âges et des tripes, vers un dieu qui pourrait sauver.
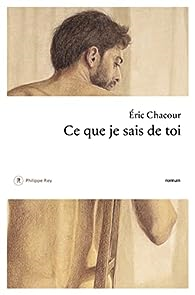
E. Chacour, Ce que je sais de toi, Philippe Rey, Paris 2023 (Prix Femina des lycéens)
On ne dit que du bien du roman d’Eric Chacour. Inutile de répéter ce que d’autres ont déjà rédigé. Au fur et à mesure que les pages se tournaient, je prenais peur. Cela allait se finir. Je voulais rester avec l’histoire, les personnages, l’auteur.
Beaucoup de douceur dans un monde de bruts, celui des préjugés et des évidences. La haine qui tue, comme s’il n’y avait pas déjà assez de la maladie ! La machination abjecte pour ne surtout pas remettre en cause ce que l’on pense, jusqu’à renier les siens. La certitude implacable d’être dans son bon-droit, puissance mortelle du dogmatisme. Ce n’est pas l’extrémisme d’une quelconque radicalité, seulement la banalité du mal sous couvert de défendre les valeurs. Violences d’abandons ou de trahisons. Mais pas un mot plus haut que l’autre, les conventions d’une culture majoritaire ou d’une microsociété en train de disparaître. Sauver la face, les apparences quitte à mourir et à tuer.
Le manque, l’absence, tiennent en haleine et font traverser les années et les océans à un ado, entre ces quatorze et dix-sept ans. Mais de celui qui occupe toutes ces pages, finalement, on ne saura pas grand-chose. Qu’a-t-il éprouvé à se découvrir un fils ? Que se sont-ils dit ? Se sont-ils aimés comme un père et son fils ?
Ne pas raconter est mensonge, dissimulation. C’est aussi la pudeur avec laquelle l’auteur considère ses personnages, une délicatesse dont ils ne ressortent que plus vivants, où se cache, cette fois, non le non-dit, mais la délicatesse. Le lecteur est ménagé par une narration qui ne se révèle explosive qu’une fois le livre reposé. Trop tard, le mal est fait, impossible de revenir en arrière. Abandonné par l’auteur, le lecteur a été mené à une forme d’expérimentation de l’abandon dont le récit vient de s’achever.

Librairie Passages, Lyon 07 02 2024
Spectacle donné à la crypte de la basilique de Fourvière, les 6, 7 et 8 octobre 2023.
Un spectacle en hommage, par un de ceux, nombreux, qui ont aimé Marcel Godard. Il y a quelque chose de l’émotion à écouter un grand-père raconter ses années d’entrée dans la vie adulte. On aimerait partager l’affection et l’hommage, on n’a pas envie d’égratigner le respect qu’inspire un maître et un père, mais…
Faut-il faire de toute vie un récit à suspens et à résolution… heureuse. Et quelle résolution ! Marcel Godard n’aura pas abandonné sa vocation de prêtre pour la musique : il sera prêtre et musicien. La formule magique a pour nom Jean-Sébastien Bach, écouté, redécouvert à Leipzig en 1943. Godard a 23 ans.
Que le Cantor de Saint Thomas ait joué un rôle dans la vie de Marcel Godard, c’est un truisme. Il reçut bien d’autres influences, dès ses jeunes années, et rien n’en est dit. On peut comprendre que l’on ne puisse retracer toute la vie, mais ces années sont-elles les plus originales et fécondes de Marcel Godard ? L’appariement texte musique paraît guère pertinent, et pour cause, ce qui a mû Godard n’est pas un épisode de sa vie de séminariste, mais sa quête, comme disciple et musicien, que rien, dans le spectacle, ne montre.
Pourquoi les effets avec un micro, pourquoi les projections vidéo sur la voute au-dessus du chœur ? Comme si l’on se servait de la technique, parce que l’on sait faire, parce que c’est ainsi aujourd’hui, mais qu’on ne savait pas que dire avec.
Le texte est ponctué, accompagné par des extraits de compositions de Marcel Godard, en direct, interprétés par le chœur Rhapsodia, Ensemble vocal dirigé par Laurent Grégoire. Si Marcel Godard s’est exprimé par la musique, c’est d’abord elle qui dit son œuvre, sa prédication, et l’on regrette qu’un texte bavard, ennuyeux même, n’ait laissé plus de place à la musique.

Une musique aux nombreuses demeures
Le service Arts, culture & foi a été informé de ce qu’un spectacle sur Marcel Godard, prêtre du diocèse de Lyon, musicien, longtemps maître de chapelle de la cathédrale, compositeur et acteur du renouveau liturgique serait donné à la crypte de la Basilique de Fourvière du 6 au 8 octobre.
L’ensemble Rhapsodia, bien connu, dirigé par Laurent Grégoire, assurera en direct la partie musicale. C’est gage de qualité.
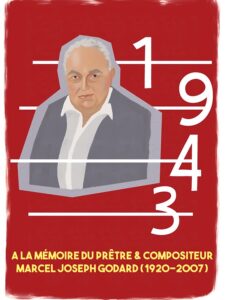

Oratorio ? Dans l’œuvre, non liturgique, Mendelssohn, nourri de Bach et tout spécialement de la Passion selon St Matthieu, retrace le parcours d’Elie. Nous entendons la prédication d’un homme marqué par les Lumières, convaincus de la nécessité hier comme aujourd’hui du prophète, non le courtisan ni l’homme providentiel, mais celui qui renverse les évidences politiques, idéologiques, religieuses et appelle au relèvement. Dans l’exil et la persécution, le psaume dit le sens de la résurrection du fils de la veuve de Sarepta : « Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres ».
Elias est l’une des dernières partitions du musicien mort à 38 ans. L’orchestre et les chœurs s’imposent plus que les solistes et les airs. C’est le style du compositeur, mais aussi l’impossibilité de penser le prophète sans le peuple qui, aux harangues royales, préfère le populisme des Baals. Elie s’enflamme contre les explications toute faites, justifications tonitruantes ou mirifiques, et signifie la bonté gracieuse et miséricordieuse que laisse reconnaître la voix de fin silence : « Homme de justice, de tendresse et de pitié ».
Réduction possible de 15%. Mail à artculture@lyon.catholique.fr avant le 30 octobre.
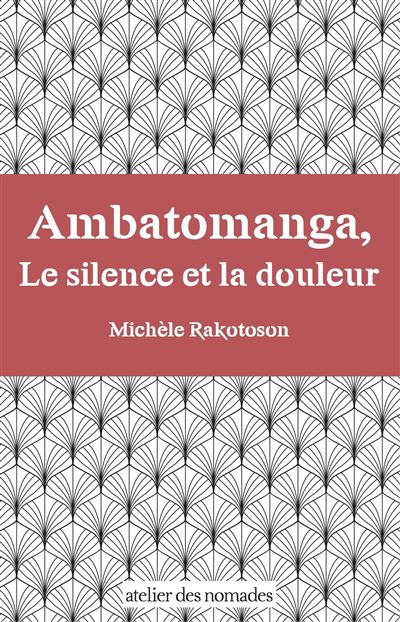 Atelier des nomades, 2022
Atelier des nomades, 2022
Le cadre est celui de la guerre coloniale française à Madagascar en 1895. Mais le récit est celui de la guerre où qu’elle se déroule, non pas les batailles, (pas une n’est racontée, si ce n’est en quelques lignes, comme un souvenir furtif), que l’horreur du renversement de la paix qui affame, détruit et tue même loin des coups de feu. L’histoire est racontée depuis deux lieux d’observations, deux personnes, un officier français et un l’esclave d’un paysan malgache. C’est la même colère contre l’inexorable de l’impuissance, la même fatigue, la même et vaine fierté patriotique aussi, qui tâche de faire taire le même abattement.
Les français envoyés pour l’œuvre de civilisation (Jules Ferry dans son discours à la Chambre de juillet 1885), eux aussi sont victimes, envoyés à la mort contre et comme leurs adversaires. Le sont encore plus leurs hommes-à-tout-faire, indigènes d’autres colonies. Les uns et les autres sont victimes d’une campagne préparée en dépit du bon sens, ignorance de la situation et du terrain par l’état-major métropolitain, intendance mal préparée, manque de défenses contre le paludisme (seulement 25 militaires perdirent la vie au combat et quasi 6000, soit 40% des effectifs, moururent de la malaria ou de dysenterie).
Le roman raconte surtout ce qui arrive aux Malgaches et ce que les Malgaches font ou ne font pas de ce qui leur arrive. La rumeur et la peur paralyse la population, plus terribles que le palud ! Le pays est déjà aux abois, pauvre, rançonné par une dette de guerre depuis une décennie. Ses chefs n’ont pas la culture guerrière des assaillants et ne savent organiser une défense qui corresponde au danger.
Quel est le sens de l’existence lorsque les pays sacrifient leurs jeunesses, parce que l’un d’enrichit sur le dos d’un autre ? Quel sens lorsqu’un pays voit sa jeunesse fauchée à cause de l’avidité d’un puissant adversaire ? Dans ce monde que la Troisième République dit vouloir civiliser pour mieux cacher ses crimes (à l’époque l’extrême droite exige plutôt l’urgence de la revanche contre l’Allemagne) et qui a déjà reçu une première évangélisation, plutôt protestante, le recours au divin, le dieu chrétien ou les dieux ancestraux, est aussi nécessaire que vain. La sagesse malgache, sa culture faite notamment d’un maniement très subtil du discours, est vouée aux poubelles de l’histoire puisque l’Ile n’a ni la richesse, ni la force.
Les appels aux divers divins perdent tout sens, au point que plus le religieux est montré, plus les religions paraissent non seulement des impasses, insensées, mais encore des poisons qui font placer un espoir dans des paroles vides. Elles sont des rois nues qui empêchent que de voir la réalité en face, un opium, un auto-asservissement. Le christianisme des colons avec ses cantiques ne dit pas autre chose que l’animisme des sauvages.
Ecrire l’histoire du point de vue des perdants, c’est non seulement leur rendre un nom, mais encore dire l’horreur de la colonisation qui consiste à « voir l’autre comme un outil de production à bas prix ». La vie des pauvres n’importe pas. Si un dieu peut sortir vivant de la colonisation et de l’évangélisation qui l’accompagna, ce sera, peut-être contre ses missionnaires, qu’il s’est rangé du côté de ceux qui ont été piétinés, depuis Naboth ou Urie et tous ceux dont Amos prend la défense en dénonçant le forfait des riches et des puissants. Que l’on ait voulu faire cesser la théologie de la libération dit de quel côté encore récemment ce sont tenus les gardiens auto-proclamés du dogme !
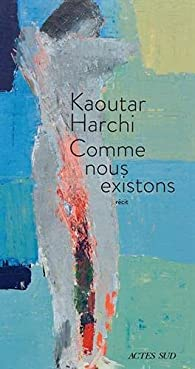 Actes Sud, Arles 2021
Actes Sud, Arles 2021
C’est un court récit qui se lit comme un roman dans une langue simple et travaillée à la fois. Mais attention, danger. Un texte peut en cacher un autre, et c’est le cas. C’est un texte de sociologie, de sociologie de l’immigration et des banlieues. Certaines pages se lisent comme un documentaire, informé, renseigné, des événements qui… ont suivi la mort de Nahel ! Le jeune homme issu de l’immigration, comme l’on dit, né en France, français, a été tué à bout portant par un agent de police le 27 juin 2023. Comme si, avant même les événements de juin dernier, l’on savait que rien n’avait changé depuis vingt, quarante ans.
De la fin des années 80 à 2010 environ, une fillette de parents marocains grandit en France. Elle découvre ce qu’elle ne sait pas encore nommer – le racisme -, non seulement à travers les insultes et vexations, mais surtout les injustices. Elle prend conscience que ce qui n’est que normal quand on l’a toujours vécu s’appelle injustice. Elle apprend à renverser la logique de pensée que la société où elle vit impose à tous, y compris à ceux qui en sont les victimes.
En fin de secondaire – c’est la seconde partie du texte – l’adolescente commence à se forger une conscience politique ce qui la conduit à engager des études supérieures en sociologie. La littérature pour l’autrice comme pour beaucoup depuis 70 ans notamment devient une arme, une manière d’agir. Sont évoqués les événements de 2005 suite à la mort de deux ados, Zyed Benna et Bouna Traoré, et la force des mères, qui élèvent leurs garçons, contrairement à ce dont tous sont convaincus.
L’écriture est calme, paisible même. L’amour de la fillette devenue jeune adulte pour ses parents qui crève chaque page, pourtant, n’empêche pas la violence volcanique que l’agencement des événements et pensées parvient à faire entendre. Il n’y a pas les méchants contre les gentils ‑ aucun adulte responsable ne peut croire que le pays de Candy existe ! Il y a une sociologie postcoloniale qui en raconte au moins autant sur ce que vivent les migrants ‑ comme ils existent ‑ que sur l’inhospitalité banale et suffisante de ceux qui se pensent chez eux, parce qu’ils ne sont ni musulmans, ni basanés, ni pauvres, parfois pas nés en France, à la différence de tant de français, qu’ils ne parviennent pas à considérer comme tels, mythe délétère d’une France blanche et chrétienne, quand bien même tellement peu croient en Dieu.
Présentation des ressorts sociologiques du texte par l’autrice ou un entretien récent.
La traduction est parue sur le site du Vatican.
On retrouve le texte ici.
« J’ai encore une chose à vous dire, qui me tient à cœur. Je voudrais vous demander de ne pas oublier les pauvres, qui sont les préférés du Christ, sous toutes les formes de pauvreté d’aujourd’hui. Même les pauvres ont besoin de l’art et de la beauté. Certains font l’expérience de formes extrêmement dures de privation de vie; c’est pourquoi ils en ont encore plus besoin. Habituellement, ils n’ont pas de voix pour se faire entendre. Vous pouvez devenir les interprètes de leur cri silencieux. »


Vincent Van Gogh, Semeur au soleil couchant, 1888
Le soleil fait auréole, la sainteté plus forte que l’arbre qui se tord sous le poids du mal, croix de l’humanité.
« Dans la paix obstinée du soir, alors que les derniers cris d’oiseau se taisent peu à peu, le semeur de Van Gogh inlassable, répète son geste. Sa main droite laisse tomber une pluie de graines bleues qui tombe sur un sol labouré par les traits de pinceau.
Dans le contre-jour le visage disparaît, le corps et la tête ne sont plus qu’une masse noire rythmée par les plis des étoffes malmenés par le travail.
Un arbre brun tourmenté, souvent taillé, traverse en diagonale le paysage. »
(Présentation de l’émission par Jean de Loisy. L’émission mérite vraiment d’être écoutée, notamment selon la perspective Arts, culture & foi)
« On ne se trompe pas si l’on parle d’un tableau religieux dans le cadre du semeur. » Lukas Gloor Historien de l’art
Lettre à Emile Bernard, juin 1888 :
« Le Christ seul – entre tous les philosophes, magiciens, etc., – a affirmé comme certitude principale la vie éternelle, l’infini du temps, le néant de la mort, la nécessité et la raison d’être de la sérénité et du dévouement. Il a vécu sereinement, en artiste plus grand que tous les artistes, dédaignant et le marbre et l’argile et la couleur, travaillant en chair vivante. C’est-à-dire que cet artiste inouï et à peine concevable, avec l’instrument obtus de nos cerveaux modernes nerveux et abrutis, ne faisait pas de statues, ni de tableaux ni de livres : il l’affirme hautement, il faisait… des hommes vivants, des immortels. C’est grave ça, surtout parce que c’est la vérité.
Ce grand artiste n’a pas non plus fait de livres ; la littérature chrétienne, certes, dans son ensemble, l’indignerait, et bien rare sont dans celle-là les produits littéraires qui, à côté de l’Évangile de Luc, des épîtres de Paul – si simples dans leur forme dure et guerrière – puissent trouver grâce. Ce grand artiste – le Christ – s’il dédaignait d’écrire des livres sur les idées (sensations), a certes bien moins dédaigné la parole parlée – la Parabole surtout. (Quel semeur, quelle moisson, quel figuier ! etc.). »