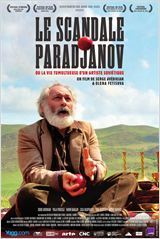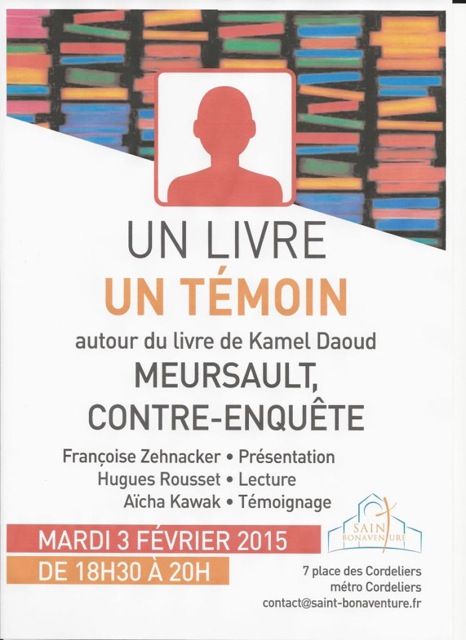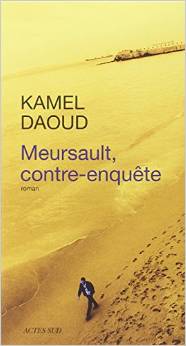Le prix Goncourt 2014 a été remis à Lydie Salvayre, pour son roman «Pas pleurer », publié au Seuil.
Plusieurs histoires sont tissées ensemble, les souvenirs de la mère de la narratrice, l’histoire de l’Espagne de la guerre civile, l’aujourd’hui de la narration (qui est celui de la mère malade et d’une France où l’extrême droite ne paraît pas si extrême, commune, une possibilité politique parmi d’autres), et le texte de combat de Bernanos, Les grands cimetières sous la lune, contemporain de la guerre, apostrophe à qui veut l’entendre, plaidoyer pour la vérité de l’évangile et la dignité de l’homme, pour l’honneur de l’Eglise et la paix civile, toutes choses indissociables.
L’ouvrage de L. Salvayre se lit d’une seule traite. S’il s’agit de grande littérature, je n’en suis pas certain, mais demeure la présence des personnages et l’ambiance une fois le livre refermé. L’auteur offre une aventure de plus, toujours nouvelle, lorsque la fiction informe, transforme, même à leur insu, ceux qui s’y livrent.
Parler de la guerre d’Espagne est une affaire encore bien impossible dans la Péninsule. En France, il se pourrait que l’on refuse une nouvelle fois, de voir ce que signifie la montée des fanatismes, (religieux, laïcards ou athées) et la banalisation des discours nationalistes. Le malaise dans la société effets de la crise économique, discrédit des institutions à commencer par la politique, et exigence que réclame de chacun un monde dont les repères ne sont plus imposés d’en haut, tout faits – suscite la peur, ébranle les identités et, de manière très archaïque, provoque à rechercher des bouc-émissaires, lesquels par définition ne sont nullement la cause des maux, mais servent à les exorciser à défaut de les guérir.
Le récit du fascisme espagnol et sa stigmatisation des communistes ou des libertaires mettent étrangement, amèrement, terriblement, en perspective la société actuelle. Les alliances ont changé, mais peut-être qu’en apparence : ce ne sont plus les Rouges que soutient la Russie, mais les Bruns. Qui sera la puissance pour les combattre ? Quant à l’Eglise, elle est encore dans le coup. Les liens de l’intransigeance catholique, formellement ou non intégriste, avec le pouvoir de Poutine ne sont plus à démontrer.
Ce que je souligne de façon trop explicite, L. Salvayre ne fait que le suggérer par son montage des intrigues, ces époques qui se superposent à trois quarts de siècle de distance, qu’une vie d’une femme incarne, sa mère. Pas besoin à l’auteur de se faire militante. Son récit s’en remet au Bernanos des écrits de combat pour réveiller les consciences, susciter l’engagement, défendre la morale, la considération de tout homme comme un frère (agis de telle sorte que tu ne considères jamais autrui seulement comme un moyen, mais toujours aussi comme une fin).
Du coup, le héros du roman vous pardonnerez cette manière si enfantine de parler pourrait bien être Bernanos qui se battit d’abord contre lui-même pour préserver la liberté d’appeler le mal par son nom, engageant sa liberté et conscience. Ce n’est pas rien, la clairvoyance de cet homme. Evidemment, c’est facile à dire quatre-vingt ans plus tard, mais tout de même. Ce n’est pas rien, que cet homme clairvoyant ait été un chrétien, je veux dire ait été clairvoyant grâce ou à cause de l’évangile. Certes, au nom du même évangile, les autres non seulement n’ont rien vu, mais plus encore, on justifié qu’il n’y avait rien à voir, ont commandé de ne rien voir. C’est qu’il ne suffit pas d’avoir des yeux pour voir ni des oreilles pour entendre. Ce ne serait pas rien si ceux sur qui l’on pourrait espérer compter pour appeler le mal par son nom se tenaient ainsi, au nom de l’évangile, avec le devoir de conscience comme source de leur liberté de parole.
Mais si au nom du Christ on a pactisé avec la Terreur, comme dit Bernanos, me dit Salvayre, que vaut l’évangile qu’un seul, dans la fiction du moins, sauve du total discrédit et du désastre qui le poursuit encore aujourd’hui en Espagne, et en tant d’autres lieux aussi ? Que L. Salvayre ne soit pas chrétienne mais qui est disciple dans la parabole du jugement de Mt 25 ? ne change rien à l’affaire, sauf à éviter l’apologétique et l’autoglorification institutionnelle, dans une sorte de récupération, bien, trop, tardive.
On ne saura plus jamais, comme deux et deux font quatre, ce que commande l’évangile, parce que l’on a fini de penser qu’il y avait un fondement à toute chose, un savoir absolu, que les prélats délivrent, eux seuls et garants. On ne saura plus jamais, si on l’a jamais su, comment il faut lutter contre le mal, comment discerner entre le mal et ce qui nous apparaît le mal. Les bonnes intentions ne suffisent pas, elles pavent l’enfer. Les justifications institutionnelles et idéologiques n’ont jamais suffi, elles ont toujours été pourries.
Salvayre rappelle que Bernanos n’était pas prédestiné, socialement, idéologiquement, institutionnellement, à dénoncer cette Terreur. Ce qui l’a fait basculer hors de son camp ne peut être réduit à une ou deux explications, sa liberté, sa conscience. Salvayre met en avant l’attachement de Bernanos à Jésus, comme St François qui habite plusieurs pages des Grands cimetières. Elle oppose un peu facilement (et rapidement) le Jésus de Bernanos à celui de l’Eglise, l’évangile à l’Eglise, passant, ici du moins, à côté de (la foi de) Bernanos. A la lueur d’une lune bien pâle, Bernanos a vu le visage du Christ sur celui des quinze fusillés par jour à l’exécution sommaire desquels on pouvait assister sur l’ile de Majorque, en s’organisant un peu et avec une voiture ! L’évangile ni l’Eglise ne l’ont empêché de voir. Au contraire, ils lui ont ouvert les yeux, Il fallait pour cela n’avoir rien à défendre (situation, reconnaissance, appartenance ecclésiale, dogme, ordre social, etc.) qui aveugle, rien à défendre si ce n’est le frère.
Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende
Patrick Royannais
C/ Lagasca 89 / 28006 Madrid / ESPAGNE
tel : (00 34) 91 435 51 60
royannais.p@orange.fr
http://royannais.blogspot.fr