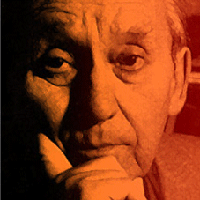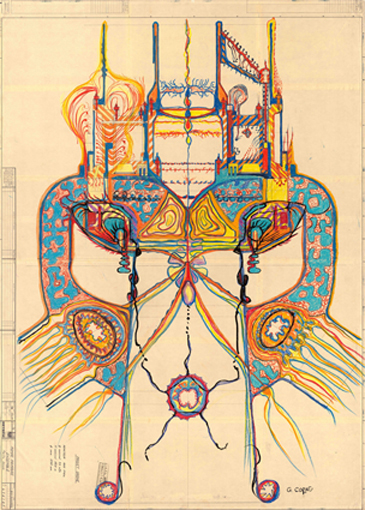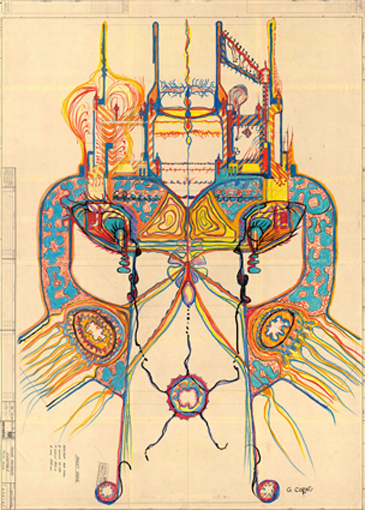Vingt sonnets à Marie Stuart

Composés en 1974, ces poèmes sont nés d’une promenade au jardin du Luxembourg, à Paris, où le poète en exil croise la statue de Marie Stuart, dans l’allée des reines de France. Marie Stuart –
Plusieurs figures de femmes qui ont compté pour lui se superposent à la silhouette de la reine d’Écosse, reine de France par son bref mariage avec François II. Dans une langue qui joue sur les deux registres du trivial et du sublime, de la citation et de son détournement, l’évocation amoureuse est l’occasion pour le poète d’une rêverie mélancolique sur l’exil et la séparation, la mémoire et l’histoire, la littérature européenne, les bifurcations de son propre destin. Le choix du sonnet, forme exemplaire de la culture européenne, est aussi un hommage à ceux écrits par Marie Stuart.

Marie Stuart
Quatre langues : une œuvre
Le choix que nous faisons de proposer aux lecteurs français une édition quadrilingue d’une aussi courte séquence poétique relève d’une évidence, tautologique comme elles le sont toutes : la traduction n’est pas seulement une restitution plus ou moins heureuse d’un texte inaccessible, elle est surtout le moment où le traducteur invente une langue dans laquelle l’œuvre originelle vient se glisser pour exister tout entière là , nulle part ailleurs, loin du triste dépit trop souvent exprimé comme une fatalité, par le lecteur ignorant la langue d’origine, que le vin de la traduction est un vin coupé d’eau. Le texte que le lecteur a sous les yeux est un vin miraculeux. Ce qu’il lit en traduction est bien le texte original d’une œuvre qui n’existera jamais pour lui autrement, le seul texte sur lequel il devra compter pour s’enivrer de vin, d’amour et de poésie. Tout traducteur est appelé à se hisser au rang d’auteur pour accomplir cette transformation miraculeuse. C’est d’autant plus vrai quand les traducteurs se nomment Peter France, Claude Ernoult, André Markowicz, ou encore, Joseph Brodsky.
L’idée de présenter dans un même livre deux versions françaises est née de notre désir d’illustrer cette évidence. Vouloir y joindre le texte russe et la traduction anglaise revue par l’auteur permet également de faire sa place à une approche traditionnelle et comparatiste de la traduction pour les lecteurs qui connaîtraient, sinon les deux, au moins l’une des langues que Brodsky maîtrisait.
Hommage à Paris
Il y a sans doute beaucoup de fidélité à un idéal de culture à vouloir célébrer de manière aussi fétichiste la poésie d’un auteur. Nous aimerions surtout que le lecteur français s’empare de la vision qui s’exprime dans ces Vingt sonnets à Marie Stuart, sonnets d’amour absolu, au-delà de la question linguistique : nulle part ailleurs dans l’œuvre de Joseph Brodsky, Paris, sa culture, et jusqu’à sa géographie n’ont été aussi présents qu’en ce texte fugitif d’un exilé venu respirer, le temps d’une brève promenade dans le jardin du Luxembourg, un idéal de liberté et de culture. Raison de plus pour faire en sorte que les lecteurs y entrent par plusieurs portes.
André Markowicz assure l’une des traductions et la postface du livre.
Cette nouveauté a suscité l’intérêt de journalistes et/ou écrivains et pas des moindres. Voici trois liens vers des recensions consacrées à cette parution :
[->http://poezibao.typepad.com/flotoir/2014/03/des-ruines-vivantes-et-vibrantes-.html](Florence Trocmé)
La République des livres (Pierre Assouline)
Le feu de Prométhée et le gourdin de Diogène
BRODSKY_LDDP_LIVRE_Né à Saint-Pétersbourg en 1940, Joseph Brodsky quitte l’école à 16 ans, préférant se cultiver seul par la lecture. Il apprend ainsi le polonais et l’anglais pour lire, entre autres, CzesÅ‚aw MiÅ‚osz et John Donne. Remarqué par la poétesse Anna Akhmatova, il acquiert dès les années 60 une réputation d’exception dans le cercle des poètes qui gravitent autour d’elle. C’est à cette époque qu’il rencontre et tombe amoureux d’une artiste proche d’Akhmatova, « M.B. », dédicataire de nombreux poèmes. Elle est l’une des figures possibles des Vingt sonnets à Marie Stuart. Abandonné par celle qu’il aimait, se déclenche dans le même temps contre lui une campagne ridiculisant sa poésie. Il est accusé par le régime soviétique de « parasitisme social ». Condamné à cinq années de camp de travail, puis libéré après une campagne internationale, Brodsky est expulsé d’URSS le 4 juin 1972, mis de force dans un avion pour Vienne. Des amis influents lui facilitent son entrée aux États-Unis, où il enseignera la littérature dans diverses universités. Il est à cette époque considéré comme le plus grand poète russe vivant du XXe siècle. Les éditions Ardis, de l’Université Ann Arbor (Michigan), publient à partir de cette date sa poésie en russe. Elle est empreinte d’une vaste culture classique, travaillée par une lucidité qui ne répugne ni au lyrisme ni au sarcasme. Sa maîtrise de la langue anglaise lui permet rapidement d’assurer ou de superviser les traductions de ses poèmes et d’écrire dans cette langue. Le prix Nobel de littérature lui est attribué en 1987. Il a quarante-sept ans. Jusqu’à cette date, ses œuvres circulaient en traduction, à l’étranger, ou en samizdat, dans son pays d’origine. Cette circonstance donne sens à notre édition. En 1990, 200 000 exemplaires de la première édition russe de ses poèmes s’arrachent en quelques jours. À partir des années 1990, l’influence intellectuelle de Brodsky est considérable aux États-Unis. Malade du cœur, le poète meurt, le 28 janvier 1996, sans jamais avoir accepté de revoir son pays natal. Il est enterré à Venise, sa deuxième patrie d’adoption. « Seule la cendre sait ce que signifie brûler jusqu’au bout. »