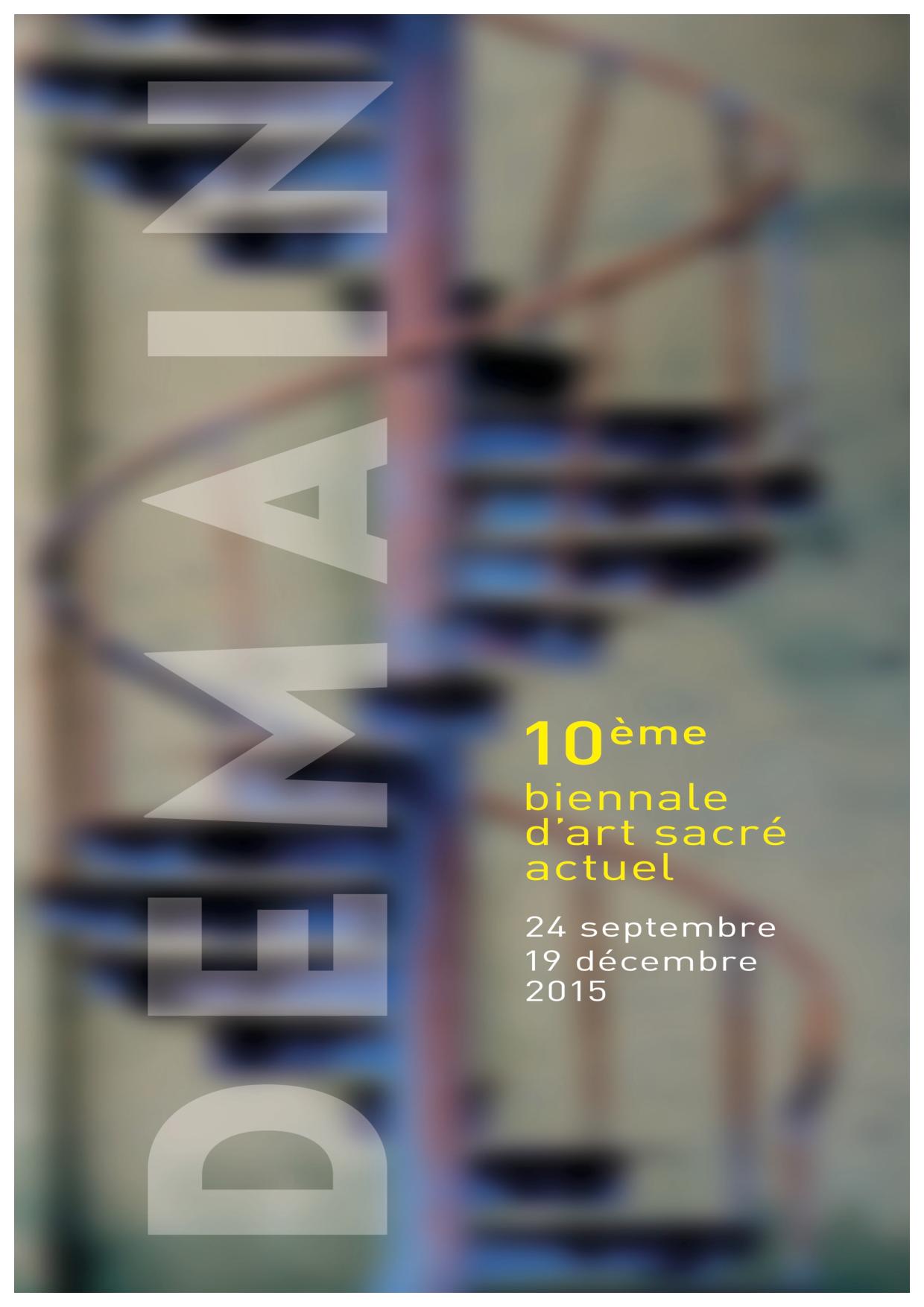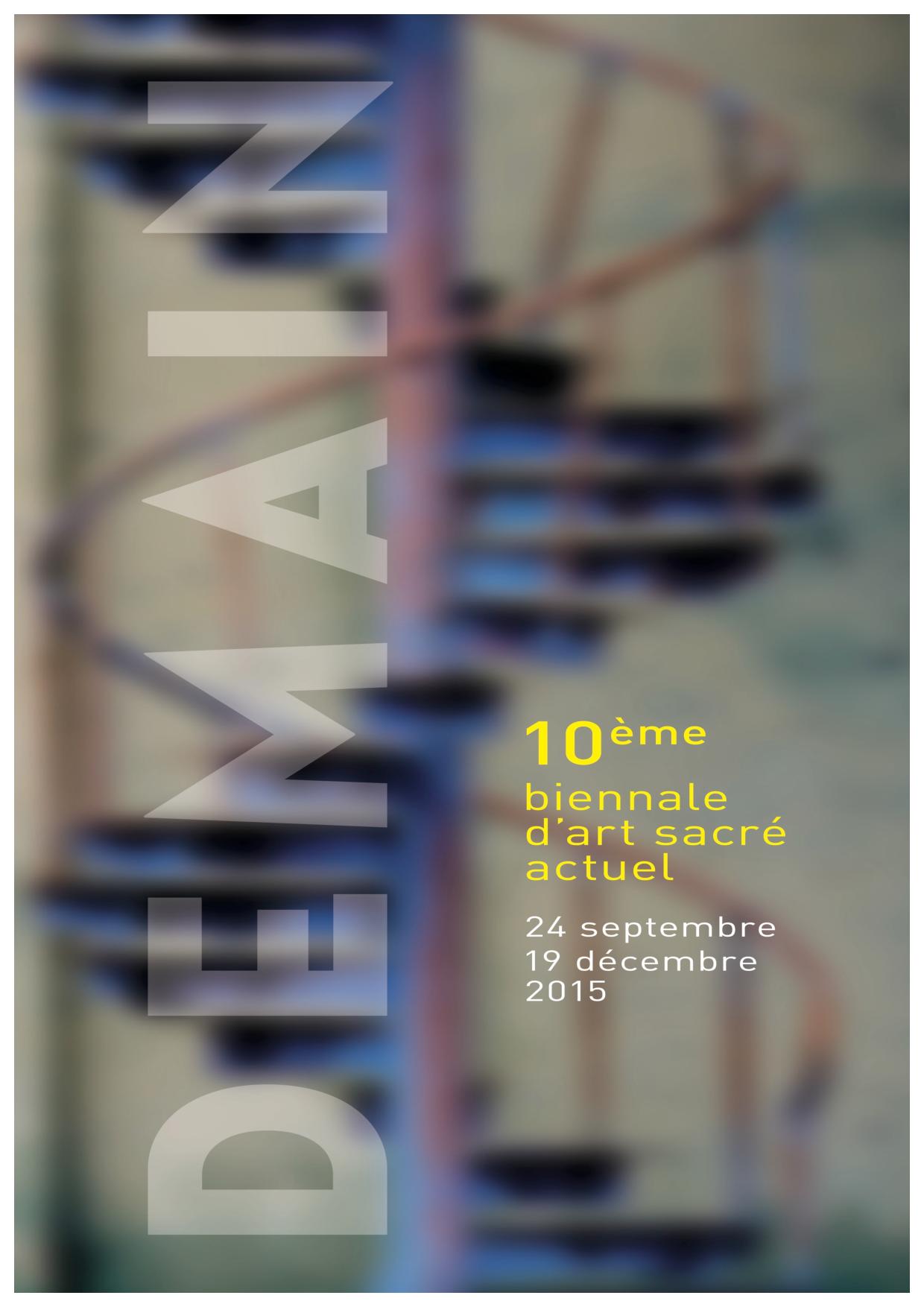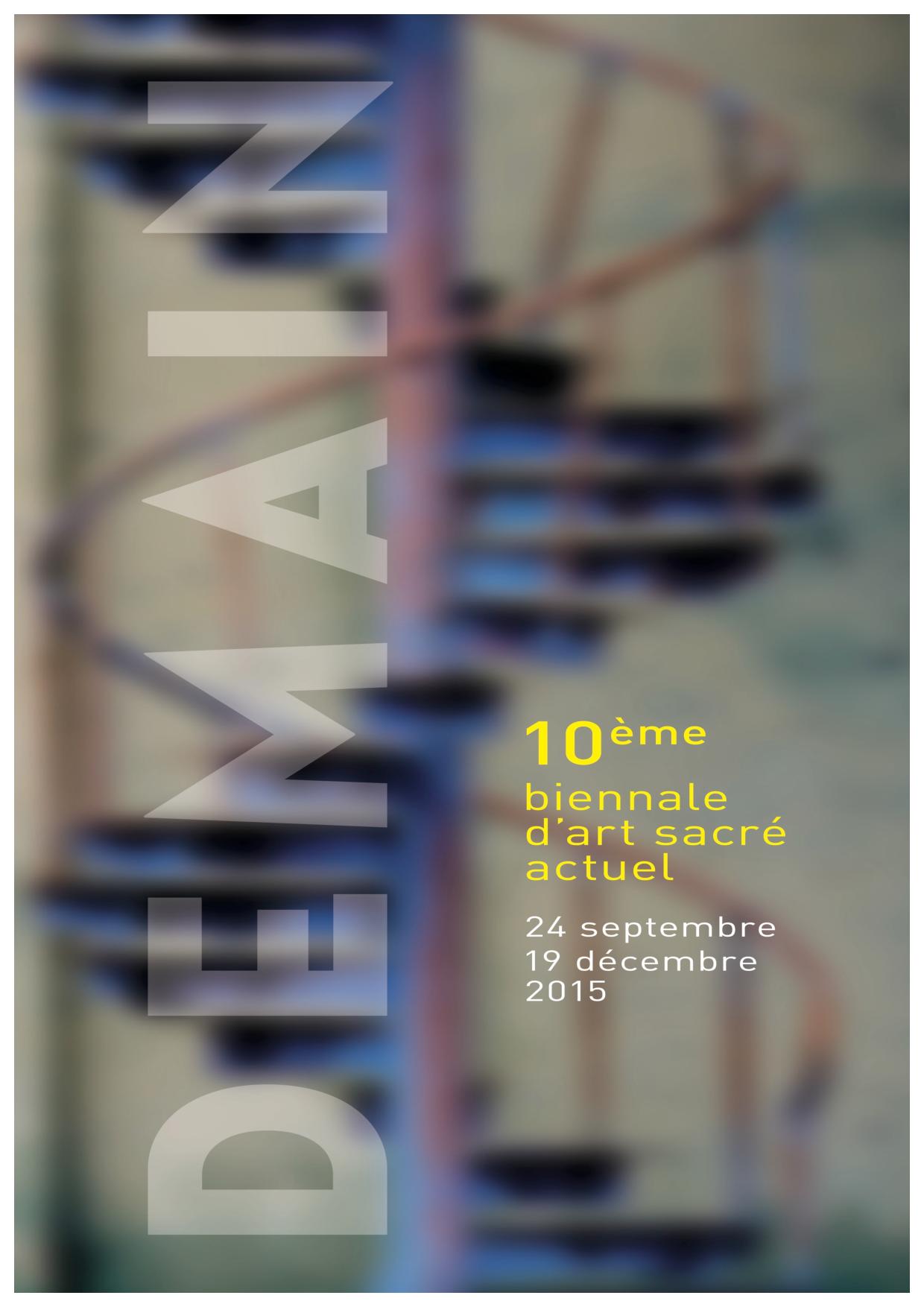
Le livre d’or
Àl’issue de l’exposition, les visiteurs ont la possibilité d’écrire sur un livre d’or. Il
est étonnant qu’il ne soit plus nécessaire de préciser à quoi sert l’objet. Celui-ci est rentré dans le champ symbolique : sa simple monstration équivaut à une parole : « vos impressions ? ». Le livre d’or vient en quelque sorte prolonger la formidable expérience de liberté que sont venues nous offrir toutes ces œuvres en ce lieu : libre de poser un regard, libre de se laisser interroger et libre de répondre. Le livre d’or en fin de parcours nous rappelle peut-être que toute liberté ne peut porter du fruit que dans une responsabilité qui, dans le cas qui nous concerne, n’est pas obligation, ni même devoir, mais possibilité de répondre de ses actes. Avant le livre d’or, le visiteur a déjà répondu dans l’acte de lecture qu’il a faite des œuvres, individuellement ou bien avec d’autres : amis, parents ou médiateurs. Mais par l’écriture, il répond par la matière à la matière. On peut parler de dialogue.
Pourquoi ce livre est-il d’or ? Quand on est embarqué dans une exposition d’art, il est d’usage de consentir à accueillir tous les signes qui se présentent. L’art du XXe siècle nous a appris à être attentifs non seulement à l’œuvre, mais également à tout ce qui l’entoure. Pour une Biennale d’Art Sacré, il n’est donc pas incongru de se demander pourquoi donner à un livre vierge appelé à être complété, la couleur du sacré. On répondra sans doute un peu rapidement que cet or n’est qu’une banale convention plastique, qu’en réalité l’or n’est mentionné que pour mettre en valeur l’objet qui autrement passerait inaperçu.
Son contenu
Je voudrais maintenant m’appuyer sur son contenu pour tenter d’approcher cet or ; en effet, un livre d’or peut se comprendre de deux façons. Soit il est tout en or ; soit il contient de l’or. De prime abord, je ne vois d’or que sur la première de couverture, sur les mots « livre d’or », de sorte que le fond et la forme se trouvent confondus. Mais la plupart du temps, le livre est déjà ouvert prêt à recevoir notre trace. Qu’y a-t-il de plus précieux que cette disponibilité ? Ce que je suis est attendu, recherché, désiré. Alors,
je peux lire des signes comme autant d’êtres en confiance.
Les premiers mots sont comme une prière : « En vous souhaitant une bonne et longue visite ». La fréquentation des œuvres devient comparable à une rencontre entre deux êtres. Il faut du temps pour apprendre à se connaître. Quelqu’un s’adresse aux artistes : « votre don à représenter la vie ». J’interprète le « représenter » moins comme une imitation de la vie que l’action de la rendre présente à nouveau sans pour autant diminuer son intensité.
La figure de l’artiste transparaît bien sûr derrière les œuvres : « ces gardiens de l’invisible », « ils nous ouvrent des chemins », autant de paroles pour dire que tout n’est pas dit, que les œuvres représentent, au sens ici de venir pour, une vision qui échappe à l’artiste. L’œuvre devient ainsi un dispositif créateur de ligne de fuite ; l’œuvre comme port du regard. Pour autant, il y a déjà de grands défis, de grandes audaces à présenter ce port. Seulement, le geste de l’artiste gagne souvent à aménager une réserve dans sa créativité, vide dans le plein qui laisse toujours à l’œuvre la possibilité toujours renouvelée d’advenir.
Les adultes
Un visiteur apprécie de « grandes générosités » ou « ses visions ». Je cherche dans mon dictionnaire et je trouve une définition de 1590 : générosité : qualité qui élève
l’homme au-dessus de lui-même. Ainsi je conserve mon regard ouvert sur le large, avec le chant des mouettes et les vapeurs iodées. Le mot vision est intéressant alors qu’il exprime une pluralité de réalités. Il est l’acte de voir, mais également l’objet du voir : canal et tableau. Ainsi lorsque je suis face à un tableau j’ai tout intérêt à apprécier autant le tableau en lui-même que moi regardant le tableau, et remonter pourquoi pas au regard de l’artiste qui élabore son œuvre. Une vision digne de ce nom doit certainement exciter jusque-là mon imagination qui saura discerner dans l’œuvre myriades de dialogues. Il n’est pas rare d’entendre dire que l’artiste expose sa vision du monde. Il y a de grandes chances pour que le monde qui m’est présenté ne soit pas vide, et même que je sois dedans. L’artiste n’a peut-être pas pensé à moi quand il a créé, mais je crois être dans son monde. À l’intersection de deux formes, je me reconnais.
Ecce homo.
Un visiteur s’est décollé du détail des œuvres : « L’homme recherche cette beauté- bonté ». Comment comprendre cette « beauté-bonté » ? Cette réflexion rejoint mon propre chemin de conversion. J’avais 25 ans, je ne me disais pas chrétien et il m’arrivait d’accompagner un ami orthodoxe le dimanche à la divine liturgie. J’ai été saisi par la beauté du chant byzantin. J’associe aujourd’hui clairement cette beauté à la bonté de Dieu qui est Seigneur et qui donne la vie. Bonté d’avoir illuminé mon cœur de cette manière-là , dans cette langue que je ne comprenais pas (le slavon) et à ce moment-là . C’est bien après que je me suis ouvert au contenu de la foi pour lequel j’avais eu ou on m’a laissé le temps d’aménager un espace. Je pouvais alors accueillir dans ma vie Jésus Christ, mort et ressuscité. Pour le croyant que je suis, l’art véritable comporte toujours le reflet de l’art divin, l’art de rejoindre l’homme là où il en est. Cette beauté-bonté pourrait être l’un des noms de Dieu.
Les enfants
Des paroles d’enfants (écrites peut-être par un adulte) simplifient souvent tout notre appareillage ou l’amplifient : « il y avait des tableaux plutôt tristes, et d’autres qui étaient un peu ce qu’on ressent quand on va au yoga, qu’on est calme ». Les enfants aussi disent sans savoir. Les mots yoga et joug ont la même racine indo-européenne. Ainsi, je suis d’accord, quand je pratique le yoga et que je regarde un tableau, je peux me sentir calme tout en consentant à porter un joug, image d’une vie complexe et qui me fait parfois terriblement souffrir. Je consens à la porter ce qui, quelque part et de manière mystérieuse, me rend calme. « Mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger » nous dit Jésus. Quand je suis face à l’art, je me prépare à porter plus de poids
qu’auparavant. Mais à mesure que je porte, j’ai mystérieusement la force pour porter.
Livre d’or
Le livre d’or ne comporte pas pour le moment beaucoup de références au thème « Demain ». J’en relève une, probablement celle d’un enfant « chrysostome » ou « bouche d’or » et qui va temporairement interrompre ma logorrhée : « C’est la vie,
demain, c’est la vie ».
Le livre d’or porte bien son nom.
Franck Castany
Rédigé avant la fin
 de la BASA, 

le 7 novembre 2015
http://confluences-polycarpe.org/wp-content/uploads/2014/05/janvier-2016internet.pdf