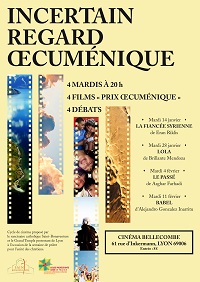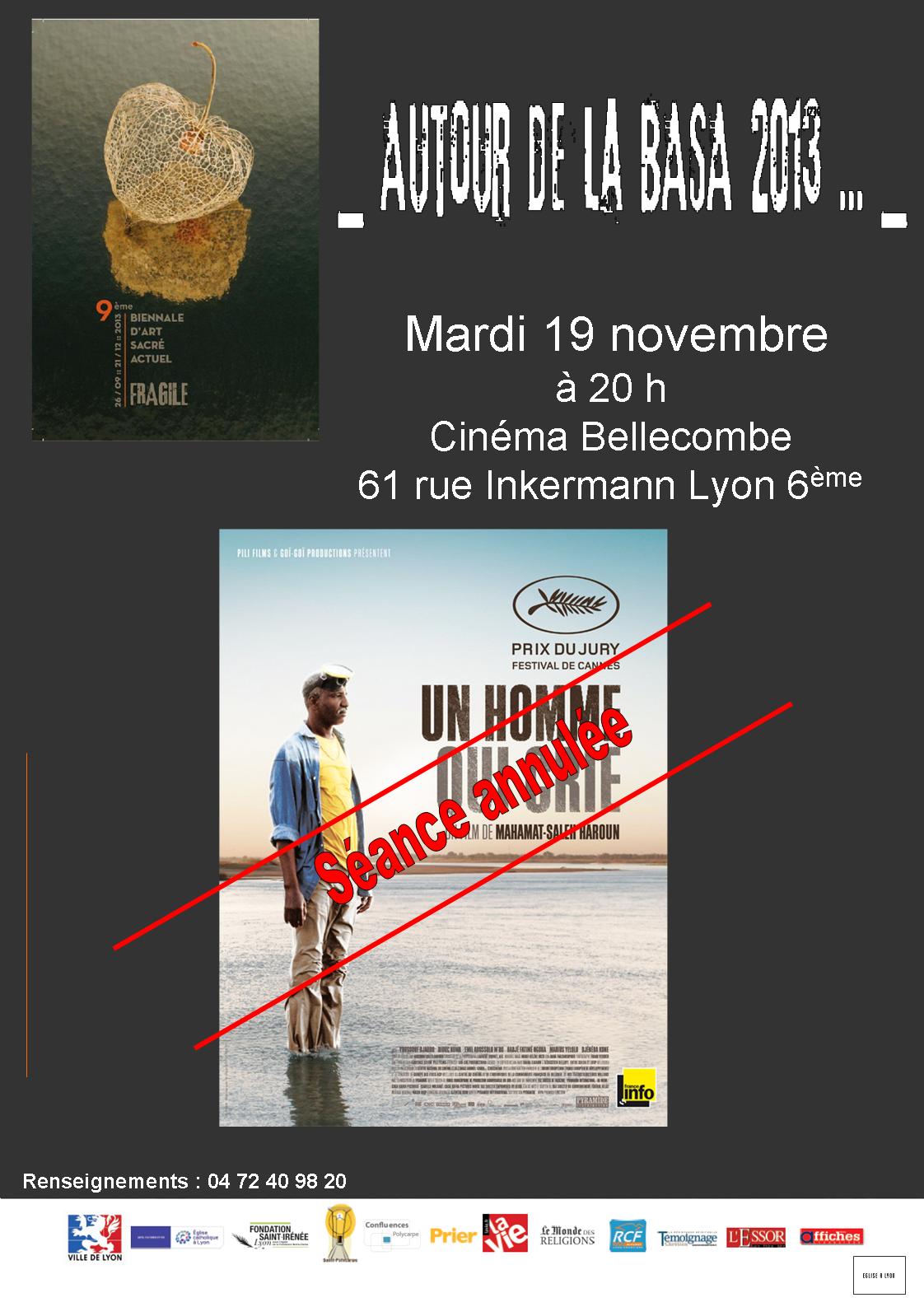de Mariana Otero
France/Belgique, 2013, 1h50
Sortie en France le 8 janvier 2014.
documentaire
Avec une belle finesse d’écriture et une réelle attention à l’autre, ce documentaire nous emmène au cœur du morcellement de personnalité dont souffrent des enfants handicapés mentaux.
Pour la réalisatrice Mariana Otero, le documentaire est un genre cinématographique où l’art et l’éthique ont une importance fondamentale. Les sujets qu’elle choisit de traiter sont ceux qui posent le problème de la construction d’un individu au sein d’un groupe. Où la place de la caméra doit être choisie avec soin pour montrer ceux qu’on filme sans les perturber, pour expliquer des situations sans les déformer, par la présence même de la caméra.
A la frontière franco-belge, un institut médico-légal, le Courtil, accueille des enfants handicapés mentaux. Non pas en les considérant comme des êtres à qui il manque quelque chose mais comme des énigmes à déchiffrer. Mariana Otero s’est glissée dans ce lieu unique, à la rencontre de ces enfants, de leurs comportements inhabituels, et de la façon tout aussi inhabituelles dont les intervenants les prennent en charge. Mariana Otero : « L’idée inaugurale de cette institution est que les enfants en souffrance psychique ne sont pas des handicapés à qui il manquerait quelque chose pour être comme les autres. Au contraire, au Courtil, chaque enfant est avant tout considéré par les intervenants comme une énigme, un sujet qui possède une structure mentale singulière, c’est-à -dire une manière originale de se percevoir, de penser le monde et le rapport à l’autre. Les intervenants, en abandonnant tout a priori et tout savoir préétabli, essaient de comprendre la singularité de chaque enfant afin de l’aider à inventer sa propre solution, celle qui pourra lui permettre de trouver sa place dans le monde et d’y vivre apaisé. »
A son tour, la réalisatrice a donc abandonné toute idée pré-conçue et, cherchant avec la caméra à comprendre ces enfants, elle s’est laissée surprendre et a su nous faire partager ses découvertes. Dans un lieu où les éducateurs frappent toujours à la porte des chambres avant d’entrer et où ils vouvoient les nouveaux arrivants, pas question de s’imposer. Après une période d’immersion où le groupe – enfants et adultes – a pu se familiariser avec elle et l’oublier au quotidien, Mariana Otero a choisi de suivre les jeunes les plus à l’aise avec la caméra ou ceux qui l’ignoraient entièrement.
A travers Alysson, Evanne et Jean-Hugues, c’est toute la construction de notre personnalité qui est questionné. Pourquoi, au seuil de l’enfance, certains individus n’arrivent pas à se « rassembler » et n’existent que comme une image en deux dimensions (comme les conversations autour de la toilette le montrent) ou se considèrent que comme la cible de toutes les attaques extérieures. Psychose ou névrose, à travers la vie quotidienne des enfants et les discussions des intervenants, on entre peu à peu dans le monde complexe de l’âme humaine et de la psychanalyse. A Ciel ouvert nous mène aussi bien dans les hautes sphères sémantiques avec les mots « jouissance » ou « semblant », que dans le concret très réaliste où on apprend comment empêcher un enfant de mettre trop de chocolat en poudre dans son bol
La différence entre la fiction et le documentaire, c’est l’impact de la caméra sur les protagonistes. Un acteur professionnel en a l’habitude et sait la charmer ou s’en protéger. Dans un documentaire, la caméra n’est jamais neutre. L’équipe du Courtil, voyant les réactions de certains jeunes, en fait un atelier en soi, qui répare, comme les autres. Pour certains enfants, elle a alors été un outil comme les autres. Les questions qu’Ewanne finit par poser sont bouleversantes. Pour une fois, on est content que la caméra est changé quelque chose.
Le titre du film, A Ciel ouvert reprend l’expression des intervenants à propos des enfants du centre : « ils ont l’inconscient à ciel ouvert ». Respectant cette « faille », Mariana Otero entre avec délicatesse dans leur univers. Son regard aide à pénétrer dans l’obscurité de ces enfants pour qui rien n’est évident et qui doivent lutter avec eux-mêmes pour ne pas rester éparpillés. On quitte le film avec Jean-Hugues, un jeune homme de 15 ans extrêmement poli et amateur de bandes dessinées (avec une forte préférence pour Les Tuniques bleues) lorsqu’il déclare devant une assemblée d’adultes : « mon cerveau est une idée ». Du grain à moudre pour tous les spectateurs !