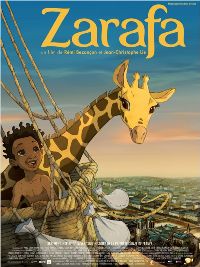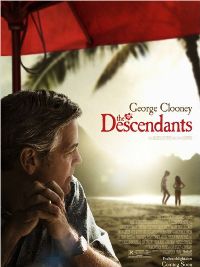d’Andrei Zviaguintsev
Russie, 2011, 1h49
Festival de Cannes 2011, Un Certain Regard, prix spécial du Jury.
Sortie en France le 7 mars 2012.
avec Nadejda Makrina, Andrei Smirnov, Elena Liadova, Alexei Rozine.
Dans un appartement calme et lumineux, au luxe un peu glacé, les tourments d’une femme pour le bien de ceux qu’elle aime. Mais entre le Bien et le Mal, difficile parfois de reconnaître ce qui est juste.
En 2003, Andrei Zviaguintsev, jeune réalisateur russe inconnu remportait le Lion d’or de Venise avec Le Retour, un film aussi fort par son sujet que par sa maitrise technique. Après avoir confirmé son talent avec Le Bannissement, voici aujourd’hui Elena, présenté dans la section Un Certain Regard du Festival de Cannes 2011, où il a été récompensé par un « prix spécial du jury ». Encore une fois, on est stupéfait et par l’ampleur du sujet et par la réalisation qui fait honneur à la grande école du cinéma russe.
Dans un bel appartement moscovite, Elena semble être la domestique de Vladimir, dont elle s’occupe avec un dévouement silencieux. Parfois, elle quitte la tranquillité luxueuse de son quotidien pour aller rendre visite à son fils et à sa famille. Long voyage en transports en commun, terminé à pied pour arriver dans une triste banlieue. Dans un minuscule logement, on discute à la cuisine autour de nourritures simples et de préoccupations qui le sont tout autant : le manque d’argent De ce manque découlent des problèmes de plus en plus complexes. Elena est coincée entre deux mondes, sollicitée par les uns, étouffée par les autres. 
Avec ce film, Andrei Zviaguintsev a voulu montrer « un drame contemporain qui tente de mettre l’homme à l’épreuve des éternelles questions de la vie et de la mort. Au tréfonds de son être, chaque individu est profondément seul. Cette solitude est le début, la fin et le fil conducteur de toute vie humaine. Dans le monde actuel, les idées humanistes se dévalorisent à vue d’oeil, poussant l’homme à se replier sur lui-même et se tourner vers ses instincts les plus anciens. »
Ce sentiment de solitude est amplifiée, en Russie comme ailleurs, par le décalage entre les riches, de plus en plus riches, et les pauvres de plus en plus déboussolés dans une société de consommation qui les attire mais à laquelle ils ne peuvent pleinement accéder. L’envie de posséder, de jouir, de consommer, de réussir est si forte, si agressive, que la morale vole en éclat Le véritable drame devient alors celui porté par Elena qui, au fond, ne veut que le bien de ceux qu’elle aime. Par amour pour eux ? Pour se sentir enfin aimée, respectée ? Est-ce un crime ? Andrei Zviaguintsev laisse le spectateur juger par lui-même : « il n’y a pas de héros dans mes films. Il y a seulement une situation dans laquelle se retrouvent des personnages. C’est une situation de choix, et c’est ce choix auquel le personnage est confronté qui est le premier héros du film. L’autre héros du film, c’est le langage cinématographique qui va montrer le comportement des personnages à l’écran ; et c’est l’idée du film qui en est l’héroïne. »
Effectivement, le langage cinématographique renforce cette notion de solitude et de déchirement. Le bouillonnement de vie dans le petit logement de banlieue répond au silence propre du désert affectif du quartier bourgeois. Tout les oppose, jusqu’au bière/cornichon des uns et au jus d’orange/muesli des autres. Elena fait des va et vient d’une moitié d’elle-même à une autre, de plus en plus seule et perdue. Le premier et le dernier plans du film, qui se répondent avec brio, parviennent à transmettre la complexité des situations qui nous attendent, et l’émotion de les avoir vécues. De grands moments de cinéma. Nadejda Makrina, célèbre actrice russe, incarne avec talent le personnage principal, Elena, cette femme douce, maternelle et effacée qui, un jour, peut se métamorphoser en monstre. Parfaite madone à l’enfant, comme le montre l’affiche, elle est l’âme tourmentée du film : dans un geste si anodin, comment ne pas céder à la tentation ? Elena est un très beau film qui pose des questions essentielles : elles nous concernent tous.




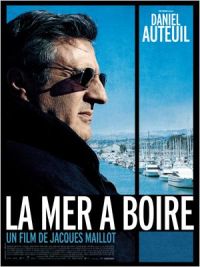

 Cette fois, l’ennemi n’est pas un monstre lointain et sans visage, un triple A anonyme, un consortium de banques, la crise mondiale dont tout le monde parle mais que personne ne peut appréhender. Dans La Mer à boire, ce qui fait chuter Georges Pierret, c’est certes un concours de circonstances lié à un contexte économique international, mais c’est aussi une succession de mauvais gestes posés par des gens en chair et en os. Comme si par là Jacques Maillot voulait nous dire que nous sommes tous responsables, à notre niveau, de certains désastres
Cette fois, l’ennemi n’est pas un monstre lointain et sans visage, un triple A anonyme, un consortium de banques, la crise mondiale dont tout le monde parle mais que personne ne peut appréhender. Dans La Mer à boire, ce qui fait chuter Georges Pierret, c’est certes un concours de circonstances lié à un contexte économique international, mais c’est aussi une succession de mauvais gestes posés par des gens en chair et en os. Comme si par là Jacques Maillot voulait nous dire que nous sommes tous responsables, à notre niveau, de certains désastres