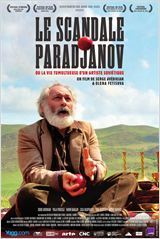de Christian Petzold
avec Nina Hoss et Ronald Zehrfeld (Film allemand 1h38).
Chroniques cinéma par Marie-Noëlle Gougeon
Nelly Lenz, juive allemande, vient d’être libérée d’un camp d’extermination. Lourdement blessée au visage, un chirurgien lui remodèle un faciès « autre que le vôtre » lui conseille-t-il. Là voilà dotée de nouveaux traits, mais encore bleuie par les suites de l’opération. Elle retrouve la ville de Berlin en ruines, si ce n’est quelques quartiers comme ceux des cabarets où s’amusent des soldats américains. C’est là qu’elle retrouve son mari, Johnny, ancien pianiste reconnu, qui fait maintenant office d’homme à tout faire. Le cabaret où il travaille s’appelle Phoenix.
En la voyant, Johnny ne la reconnaît pas mais ébranlé par la ressemblance, il établit un plan machiavélique : que Nelly se fasse passer pour sa femme, qu’il croit morte comme toute sa famille. Ainsi elle héritera et lui aussi de la moitié de la fortune de ses parentsNelly accepte car d’abord elle l’aime, ensuite, elle veut mesurer l’attachement qu’il lui a réellement gardé puisqu’une de ses amies lui a avoué qu’il avait divorcé deux jours après son arrestation : il l’a donc trahie !
Un drôle de jeu se met en place alors. Johnny-Pygmalion façonne Nelly à l’image de celle dont il a gardé le souvenir et dont on ne verra jamais le portrait d’avant guerre qui restera un fantasme, un souvenir.
Nelly joue le jeu, un jeu redoutable car elle est la « vraie » Nelly et en même temps otage du plan de son mari.
A quel moment et comment la vérité éclatera ?
Christain Petzold compose un vrai thriller psychologique cernant ces personnages dans des huis-clos sombres et angoissants. Les décors sont minimalistes, dépouillés ou enchâssés dans une nuit éclairée de lumières froides
On sent encore le goût de cendres de la guerre, les soupçons sur chaque voisin (était-il nazi ?), l’impossible retour de ceux qui rentrent des camps, et leur témoignage qu’on ne veut pas entendre. Petit à petit, Johnny impose à Nelly de porter les habits de son épouse, (une robe rouge qui symbolise à la fois la vie qui revient mais aussi le rouge du sang des victimes). Il lui commande de se coiffer, de se maquiller, d’écrire comme elle.
Mais qui donne la vérité d’un être : son aspect physique, sa démarche, son écriture ? Johnny se trompe..
Nelly lui obéit mais lui échappe en même temps, ou plutôt elle construit en elle-même sa résistance à ce plan pervers, elle sait jusqu’où elle ira.
La dernière séquence du film se déroule dans une gare avec la rencontre de la famille de Johnny donc son « ancienne belle-famille ». Johnny croit avoir réalisé son plan. La séquence est un pur moment de cinéma
Nelly dit enfin sa vérité en dévoilant son numéro de prisonnière tatoué sur le bras et en chantant d’une façon déchirante Speak low, pour montrer son amour, une chanson sur une musique de Kurt Weill, qu’elle chantait avant la guerre avec son mari. Elle va faire tomber les masques, et pétrifier Johnny. Il découvre tout d’un coup la réalité: Nelly était réellement sa femme. Mais c’est trop tard L’image se brouille Sublime dernier plan..
Nina Hoss habite littéralement le rôle de Nelly et elle est formidablement émouvante.
Ronald Zehrfeld mêle avec brio la perversion du personnage et la séduction de l’ancien mari.
A l’heure du 70 ème anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz, Christaian Petzold nous offre avec Phoenix un film grave, brillamment réalisé et à l’honneur du cinéma allemand.