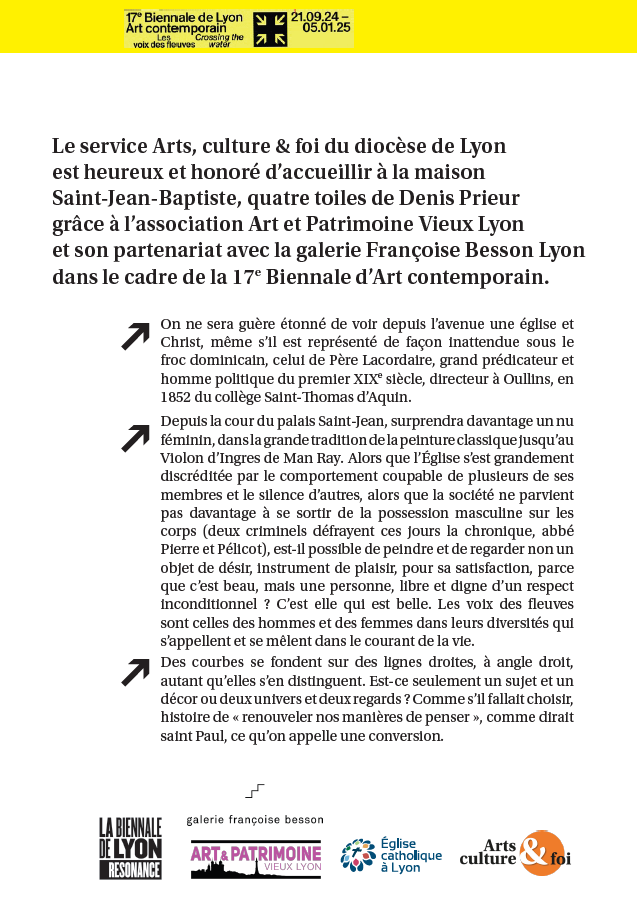



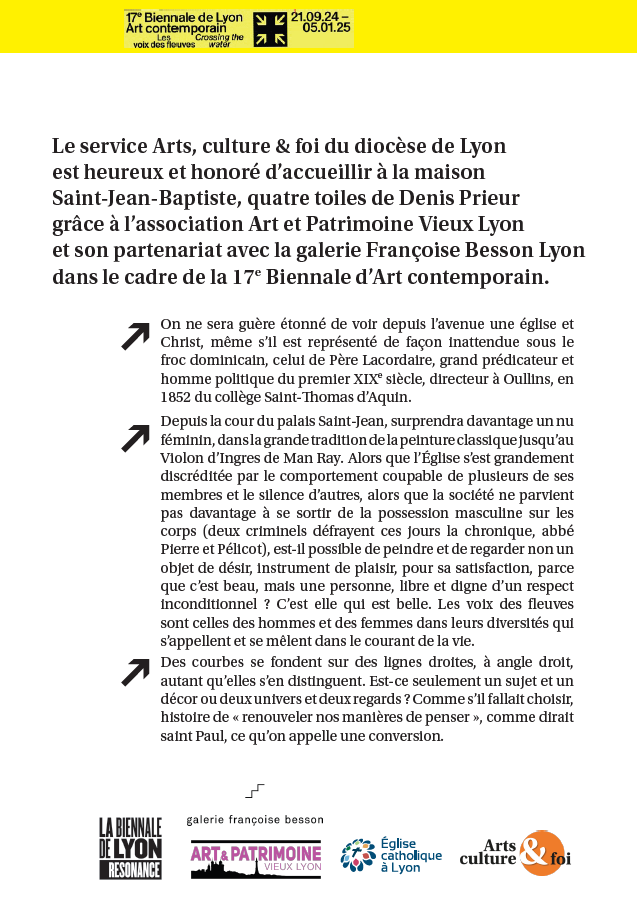




Depuis huit ans, un festival d’art sacré se déroule à Vaulx-en-Velin et trois communes limitrophes, Décines, Meyzieu et Jonage. En 2024, Arta sacra a lieu du 20 au 28 septembre. Spectacles, ateliers, expositions et conférences sont proposés pour faire vivre le patrimoine culturel de diverses communautés religieuses et permettre une rencontre entre eux des citoyens et habitants de la Métropole, croyants ou non.
Une image peut créer le trouble, et l’artiste aura réussi son geste, de l’émotion la plus douce jusqu’à la perception violente d’un blasphème. L’art, notamment sacré, joue toujours avec le feu, à moins de n’être qu’illustration mièvre et insipide. Faudra-t-il lui imposer de n’être pas figuratif ? La vision est risquée pour l’artiste comme pour le spectateur ; autant d’occasions pour « renouveler nos manières de penser ».
Vendredi 20 septembre à l’église de Jonage, Baptiste Frelat accompagne au oud le chant d’Andrew Adeeb. En arabe ou en araméen, langue parlée par le Christ, de l’Iraq au Liban, les pièces choisies appartiennent à la tradition des chrétiens d’Orient. Des mélodies qui ont traversé les siècles côtoient des compositions plus récentes. Ils seront aussi présents mardi 24 à 19h30 à l’église de l’Assompton de Vaulx-en-Velin
Réservation dès le 26 août. Plus d’infos : https://www.facebook.com/festivalartasacra
Il y a 25 ans, le Musée d’art moderne de la ville de Paris avait consacré une exposition à Mark Rothko. Puis, la Fondation Beyeler deux ans plus tard. La Fondation Louis Vuitton propose une nouvelle exposition jusqu’au 2 avril 2024.
Dans ce cadre, plusieurs manifestations ou publications trouvent place, notamment la réédition du livre remanié de Annie Cohen-Solal, Mark Rothko, Folio, Gallimard 2023. M.-A. Ouaknin a reçu l’autrice dans deux émissions de Talmudiques, les deux derniers dimanches de décembre 2023.

Que se passe-t-il quand on déambule et plus encore s’assoit devant les toiles de Rothko ? On rappelle qu’il donna des consignes précises pour l’accrochage, toiles à deux ou trois dizaines de centimètres du sol, lumière tamisée, mur des cimaises « coquille d’œuf ».
Comme en 1999 et 2001, l’exposition est chronologique et, si l’on est certes intéressé par les travaux d’avant 1950, on entre dans un autre univers quand on se retrouve face aux grands panneaux, avec leurs rectangles vibrants, « stridents de couleur », flottant l’un au-dessous de l’autre. Les différents espaces du bâtiment de Frank Gehry permettent des ambiances chaque fois originales. Il y a les grandes salles où sont accrochées plus d’une dizaine de toiles ou, comme pour un cabinet de travail, les quelques mètres-carré qui enveloppent le visiteur comme dans un cocon, une matrice. On retrouve l’idée des Rothko’s rooms de différents musées et de la chapelle de Houston. Toujours est offerte une impression d’entrer dans l’espace, de toucher l’espace, ce qui n’est déjà pas rien, alors même que, et ce n’est pas le moindre des paradoxes, les toiles ne sont « que » surface.

De même, on entre dans la toile, ou plutôt chacune nous absorbe, nous embrasse, faisant toucher la couleur, parfois vive, parfois sombre à l’excès, parfois grise. La couleur devient matière. Le spectateur, si l’on ose dire, est incité à participer à ce qu’il voit, à passer de ce qu’il voit à sa propre vie que la toile lui offre en miroir. C’est que le peintre essaie de raconter autre chose que le déjà connu en permettant d’expérimenter une manière d’être que la toile ordonne. On sort de l’exposition apaisé, reposé, ne sachant plus quand ni où commence et finit le monde ‑ certainement pas à ce qui nous enserre, encadre ‑, ne souhaitant plus en être préoccupé. Autre paradoxe, ce qui referme l’espace et le temps les ouvrent infiniment. L’espace de la toile devait « devenir quelque chose par lequel on pouvait entrer. Les tableaux étaient des portes donnant vers l’inconnu. » Il y a de l’exil dans cette expérience, comme Abraham « parti sans savoir où ». La matière se fait espace, l’aplat énergie, la couleur forme et même « silence solennel » (S. Preston). Comme si l’oxymore seul permettait de parler des toiles de Rothko, « luxuriance que l’austérité laisse transparaître ».

Le travail du peintre est éthique, non comme message ou leçon de morale, mais comme acte, « une forme d’action sociale » dit Rothko, tikoun olam, dit Ouaknin à la suite de Cohen-Solal, réparation du monde par un engagement politique, lutte des classes, critique du capitalisme dans le marché de l’art, justice sociale. D’une part, toute forme nationaliste, isolationniste d’art, comme le dit un ami peintre pendant le second conflit mondial « n’est qu’une autre forme d’hitlérisme », d’autre part, ainsi que l’écrit Rothko, « une peinture vit par l’amitié, en se dilatant et en se ranimant dans les yeux de l’observateur sensible. Elle meurt pareillement. » Le spectateur sensible, l’ami, n’est pas celui que Rothko a rencontré et aimé, lui qui s’est fâché avec tant de monde, mais celui qui accepte d’être ami bien au-delà de ce que les circonstances imposent, ami de quiconque, en humanité, celui qui refuse de réduire le monde à son champ, son territoire, nation contre d’autres.
Le jeune enfant juif aura-t-il gravé en la mémoire du vieux peintre que l’interdit de la représentation ou équivalemment celui de prononcer le Nom n’est autre que la condamnation de l’idolâtrie, laquelle flanque dans l’identité sa divinité tutélaire. Avec la couleur, Rothko fait résonner le Nom sans nom en épelant la vibration du monde au rythme de la beauté et de la justice. A défaut de réparer le monde, on peut au moins en prendre soin et, le voir, le contempler, le toucher, le pénétrer, l’art le rend possible.

La lumière a brillé dans les ténèbres
Vincent Breed
Artiste verrier
Le service Arts, culture & foi du diocèse de Lyon
a demandé à Vincent Breed une création à l’occasion de l’Avent 2023,
de la fête de l’Immaculée Conception et du Temps de Noël.

Des vases fermés ou des bornes milliaires, gestation ou points d’étape, la vie, une route.
Sombres, d’un violet ténébreux puis, sans que l’on sache comment, miroir argenté qui reflète la rue, les passants.
Au sol des éclats de verre, comme un chaos, vitrine cassée ou bouteilles de soûlards, et pourtant, ce n’est pas une décharge.
Le monde ordinaire, le nôtre – notre reflet sur les bornes.
Deux questions en forme d’affirmation : « Je suis qui », « Je fais quoi ». Il faut relever la tête.
A peine visibles, des points de lumière venus d’ailleurs, pas de la rue.
Le monde – le nôtre, visité. C’est à peine visible. Il n’y a rien qui aveugle, dénonce, écrase. Les tessons même en sont transpercés et se muent en tapis royal.
Seulement mêlée au monde, une lumière brille dans les ténèbres.

Conférences par le frère Marc CHAUVEAU, dominicain, historien de l’art
Mardi 7 novembre 2023 de 15h à 17h : Nicolas de Staël
Couvent du Saint Nom, 93 rue Tête d’Or, Lyon 6

Vincent Van Gogh, Semeur au soleil couchant, 1888
Le soleil fait auréole, la sainteté plus forte que l’arbre qui se tord sous le poids du mal, croix de l’humanité.
« Dans la paix obstinée du soir, alors que les derniers cris d’oiseau se taisent peu à peu, le semeur de Van Gogh inlassable, répète son geste. Sa main droite laisse tomber une pluie de graines bleues qui tombe sur un sol labouré par les traits de pinceau.
Dans le contre-jour le visage disparaît, le corps et la tête ne sont plus qu’une masse noire rythmée par les plis des étoffes malmenés par le travail.
Un arbre brun tourmenté, souvent taillé, traverse en diagonale le paysage. »
(Présentation de l’émission par Jean de Loisy. L’émission mérite vraiment d’être écoutée, notamment selon la perspective Arts, culture & foi)
« On ne se trompe pas si l’on parle d’un tableau religieux dans le cadre du semeur. » Lukas Gloor Historien de l’art
Lettre à Emile Bernard, juin 1888 :
« Le Christ seul – entre tous les philosophes, magiciens, etc., – a affirmé comme certitude principale la vie éternelle, l’infini du temps, le néant de la mort, la nécessité et la raison d’être de la sérénité et du dévouement. Il a vécu sereinement, en artiste plus grand que tous les artistes, dédaignant et le marbre et l’argile et la couleur, travaillant en chair vivante. C’est-à-dire que cet artiste inouï et à peine concevable, avec l’instrument obtus de nos cerveaux modernes nerveux et abrutis, ne faisait pas de statues, ni de tableaux ni de livres : il l’affirme hautement, il faisait… des hommes vivants, des immortels. C’est grave ça, surtout parce que c’est la vérité.
Ce grand artiste n’a pas non plus fait de livres ; la littérature chrétienne, certes, dans son ensemble, l’indignerait, et bien rare sont dans celle-là les produits littéraires qui, à côté de l’Évangile de Luc, des épîtres de Paul – si simples dans leur forme dure et guerrière – puissent trouver grâce. Ce grand artiste – le Christ – s’il dédaignait d’écrire des livres sur les idées (sensations), a certes bien moins dédaigné la parole parlée – la Parabole surtout. (Quel semeur, quelle moisson, quel figuier ! etc.). »

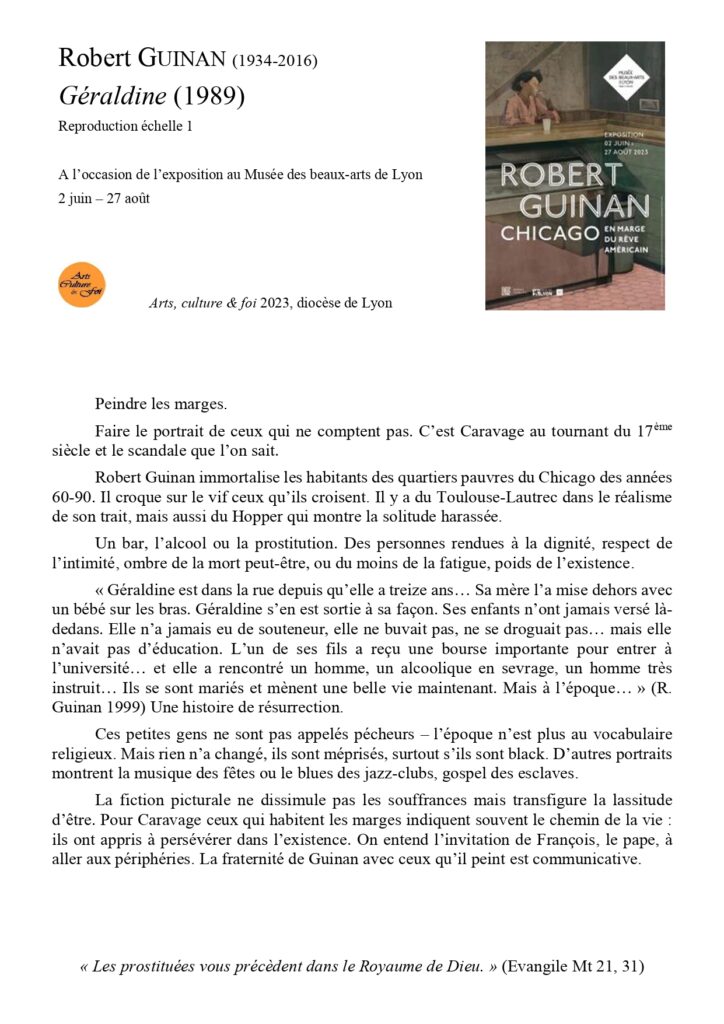

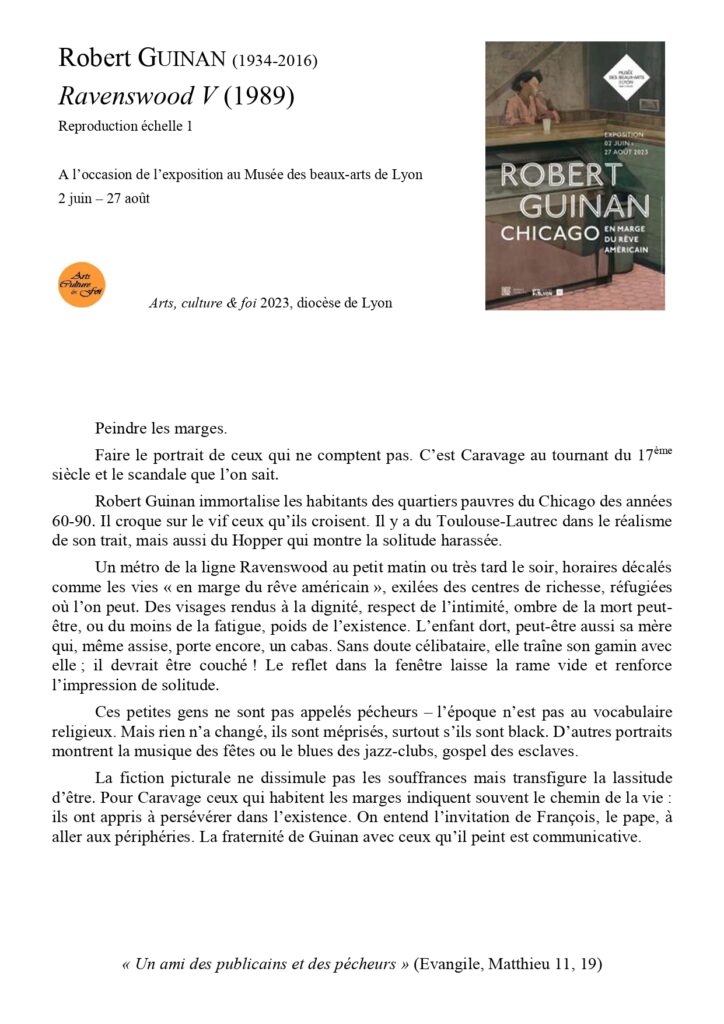

Peindre les marges, faire le portrait de ceux qui ne comptent pas. C’est Caravage au tournant du 17ème siècle et le scandale que l’on sait.
Robert Guinan (1934-2016) immortalise les habitants des quartiers pauvres du Chicago des années 60-80. Il croque sur le vif ceux qu’ils croisent à la façon de Toulouse-Lautrec et montre leur solitude harassée comme Hopper. Les portraits posés arrivent plus tard, mais toujours le secret des personnes.
Un métro au petit matin ou très tard le soir, horaires décalés comme les vies « en marge du rêve américain », exilés des centres de richesse, réfugiés où l’on peut. Un bar, l’alcool ou la prostitution. Visages estompés comme pour en protéger la dignité et l’intimité à moins que déjà la mort ne projette son ombre, Memento mori. La musique des fêtes ou le blues des jazz-clubs comme autrefois le gospel des esclaves.
La fiction picturale crie les souffrances et transfigure la lassitude d’être. On entend l’invitation de François d’aller aux périphéries. Caravage engage à vivre la foi par la non idéalisation de ses modèles ; la fraternité de Guinan, complice et sans complaisance, avec les siens est communicative. Ordinaire et profane, blessée aussi, la vie plus grande.

Si l’on ne sait pas ce que représente la toile de Jordaens (1515-1516), pas sûr qu’on l’identifie facilement.
Il y a un blessé hissé sur une monture, à moins qu’il n’en soit descendu. C’est l’indice le plus facile. Mais beaucoup de monde et un citoyen si richement vêtu qu’on peine à le reconnaître. Il est vêtu d’un manteau pourpre, la tête couronnée d’un turban.
Le Bon Samaritain entraine dans sa bonté beaucoup de monde. Ses mains sont posées, protectrices, sans distance, sur le corps maltraité. Il y a le serviteur qui aide à porter le blessé, et ceux qui regardent, étonnés par tant de magnanimité. La charité est ce qui interroge.
Pas sûr qu’il faille reconnaître l’aubergiste sauf si l’on assiste à l’arrivée à l’auberge. Mais le Samaritain paraît bien peu fatigué et sali par sa marche, alors qu’il avait laissé au moribond son cheval.
Il y a du mouvement, la crinière montre un mouvement, comme si l’on était non arrivé, mais en route. « La charité nous presse. »
Fait face au Samaritain un serviteur, dénudé comme le blessé. Il partage avec lui la nudité qu’il embrasse. Avec le Samaritain, il encadre le blessé ; le positionnement de leurs jambes se répond comme dans un miroir. Faut-il y voir les deux natures du Christ, la beauté étrange (celle d’un oriental enturbanné qui surprend l’européen) de sa divinité, son humanité qui embrasse la nôtre, en forme d’esclave, semblable à celui qui était sur le point de mourir définitivement sans lui ?
Le dessin s’inscrit dans un V qui va du turban du page à gauche, passe par une jambe du serviteur nu, et remonte par la jambe du riche oriental jusqu’à son turban.