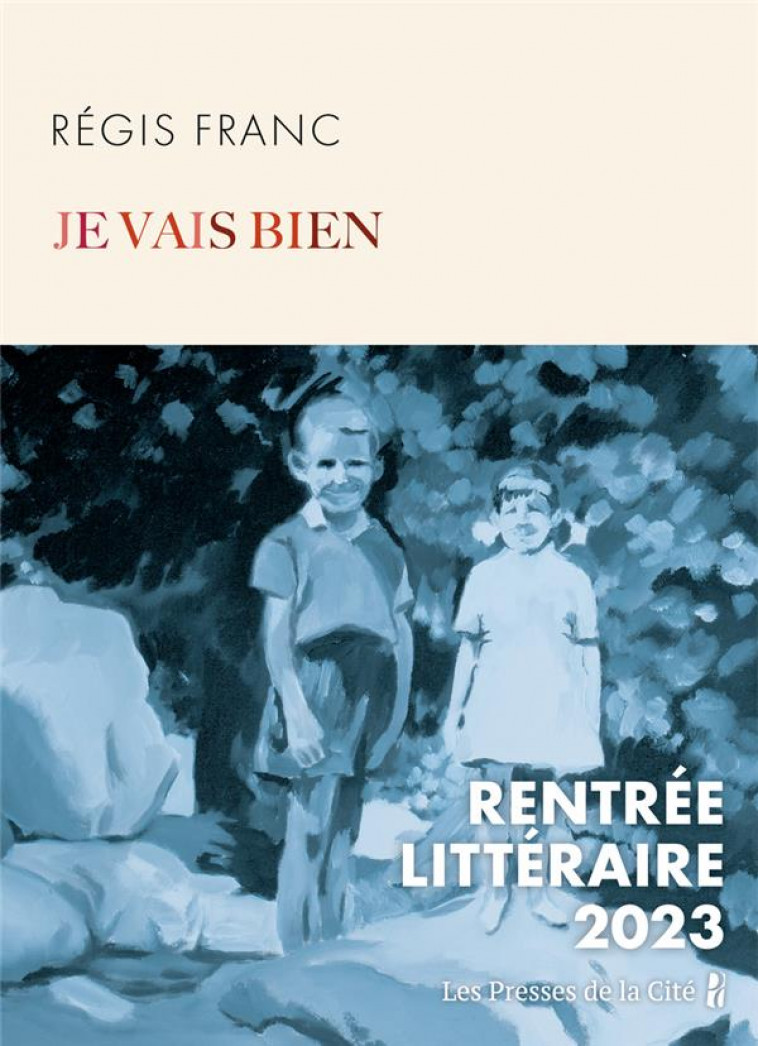Une lettre du Pape a été publiée mi-juillet 2024 sur la place de la littérature dans la formation au ministère ordonné. Dans l’introduction, le Pape affirme que ses propos ne font pas sens seulement dans le cadre des séminaires mais qu’ils valent pour la vie de tout disciple. On pourrait se demander en quoi un tel texte mérité attention. Aucun des spécialistes de littératures n’est cité. François ne parle-t-il pas davantage comme un grand-père à ses arrière-petits-enfants les encourageant à lire, que comme celui qui vient enrichir la doctrine catholique avec une nouvelle publication ?
Que l’on ne s’y trompe pas, c’est toute sa théologie de la vie chrétienne que l’on peut lire dans ces lignes : François dit une fois encore en quoi consiste la vie des disciples : accueil, miséricorde, rencontre des périphéries et des étrangers dont bien trop sont si souvent ignorants au point de les rejeter et de les mépriser, de vouloir s’en débarrasser.
Le professeur William Marx, titulaire de la chaire de littérature comparée au Collège de France et Frédéric Boyer, écrivain, traducteur, éditeur et chroniqueur ont attiré l’attention sur cette lettre de François.
Tribune du Pr. W. Marx, Le Monde 23 08 2024
Chronique de F. Boyer La Croix, 08 09 2024
LETTRE DU PAPE FRANÇOIS
SUR LE RÔLE DE LA LITTÉRATURE DANS LA FORMATION
1. J’avais initialement écrit un titre se référant à la formation sacerdotale, mais j’ai ensuite pensé que, de la même manière, ces choses peuvent être dites à propos de la formation de tous les agents pastoraux, comme de n’importe quel chrétien. Je veux parler de l’importance de la lecture de romans et de poèmes dans le parcours de maturation personnelle.
2. Souvent, dans l’ennui des vacances, dans la chaleur et la solitude de certains quartiers déserts, trouver un bon livre à lire devient une oasis qui nous éloigne d’autres choix qui ne nous feraient pas du bien. Il y a aussi les moments de fatigue, de colère, de déception, d’échec, et lorsque nous ne parvenons pas, même dans la prière, à trouver la tranquillité de l’âme, un bon livre nous aide à traverser la tempête jusqu’à ce que nous retrouvions un peu de sérénité. Et peut-être cette lecture nous ouvre-t-elle de nouveaux espaces intérieurs qui nous aident à ne pas nous enfermer dans les idées obsessionnelles qui nous tiennent inexorablement. Avant que les médias, les réseaux sociaux, les téléphones portables et autres dispositifs deviennent omniprésents, cette expérience était fréquente, et ceux qui l’ont connue savent de quoi je parle. Il ne s’agit pas d’une chose dépassée.
3. Contrairement aux médias audiovisuels où le produit est plus complet et où la marge et le temps pour “enrichir” le récit et l’interpréter sont généralement réduits, le lecteur est beaucoup plus actif dans la lecture d’un livre. Il réécrit en quelque sorte l’œuvre, l’amplifie avec son imagination, crée un monde, utilise ses capacités, sa mémoire, ses rêves, sa propre histoire pleine de drames et de symboles. Et ce qui en ressort est une œuvre bien différente de celle que l’auteur voulait écrire. Une œuvre littéraire est donc un texte vivant et toujours fécond, capable de parler à nouveau de multiples façons et de produire une synthèse originale avec chaque lecteur qu’elle rencontre. Dans la lecture, le lecteur s’enrichit de ce qu’il reçoit de l’auteur, mais cela lui permet en même temps de faire fleurir la richesse de sa propre personne, de sorte que chaque nouvelle œuvre qu’il lit renouvelle et élargit son univers personnel
4. Cela m’amène à apprécier très positivement le fait que, au moins dans certains séminaires, l’on dépasse l’obsession des écrans -et des fausses nouvelles empoisonnées, superficielles et violentes – pour consacrer du temps à la littérature, à des moments de lecture sereine et gratuite, et à parler de ces livres, nouveaux ou anciens, qui continuent de nous dire tant de choses. Mais, d’une manière générale, il faut constater avec regret que, dans la formation de ceux qui sont destinés au ministère ordonné, l’attention à la littérature ne trouve pas actuellement une place adéquate. Celle-ci est en fait souvent considérée comme une forme de divertissement, c’est-à-dire une expression mineure de la culture qui n’appartiendrait pas au chemin de préparation, et donc à l’expérience pastorale concrète, des futurs prêtres. À quelques exceptions près, l’attention portée à la littérature n’est pas considérée comme essentielle. Je voudrais affirmer que cette approche n’est pas bonne. Elle est à l’origine d’une forme grave d’appauvrissement intellectuel et spirituel des futurs prêtres qui sont ainsi privés d’un accès privilégié, par la littérature, au cœur de la culture humaine et plus précisément au cœur de l’être humain.
5. Par cette lettre, je souhaite proposer un changement radical de démarche concernant la grande attention qui doit être portée à la littérature dans le cadre de la formation des candidats au sacerdoce. À cet égard, je trouve très pertinent ce que dit un théologien :
« La littérature […] jaillit de la personne dans ce qu’elle a de plus irréductible, dans son mystère […]. Elle est la vie qui prend conscience d’elle-même lorsqu’elle atteint la plénitude de l’expression, en faisant appel à toutes les ressources du langage ». [1]
6. La littérature a donc à voir, d’une manière ou d’une autre, avec ce que chacun désire de la vie, puisqu’elle entre en relation intime avec son existence concrète, avec ses tensions essentielles, ses désirs et ses significations.
7. J’ai appris cela jeune avec mes étudiants. Entre 1964 et 1965, à 28 ans, j’ai été professeur de littérature à Santa Fe dans une école de jésuites. J’enseignais les deux dernières années du lycée et je devais veiller à ce que mes élèves étudient Le Cid. Mais les jeunes n’aimaient pas ça. Ils demandaient à lire García Lorca. J’ai donc décidé qu’ils étudieraient Le Cid à la maison et que, pendant les cours, je traiterais d’auteurs que les jeunes préféraient. Bien sûr, ils voulaient lire des œuvres littéraires contemporaines. Mais, au fur et à mesure qu’ils lisaient les choses qui les attiraient sur le moment, ils acquéraient un goût plus général pour la littérature, pour la poésie, et passaient ensuite à d’autres auteurs. En fin de compte, le cœur cherche davantage, et chacun trouve sa voie dans la littérature. [2] J’aime, par exemple, les artistes tragiques parce que nous pouvons tous ressentir leurs œuvres comme nôtres, comme expression de nos drames. En pleurant sur le sort des personnages, nous pleurons en réalité sur nous-mêmes et sur notre vide, sur nos défauts, sur notre solitude. Bien sûr, je ne vous demande pas de faire les mêmes lectures que moi. Chacun trouvera des livres qui parlent à sa propre vie et qui deviendront de véritables compagnons de route. Il n’y a rien de plus contre-productif que de lire par obligation, de faire un effort considérable juste parce que d’autres ont dit que c’est essentiel. Non, nous devons choisir nos lectures avec ouverture, surprise, souplesse, en nous laissant conseiller, mais aussi avec sincérité, en essayant de trouver ce dont nous avons besoin à chaque moment de notre vie.
Foi et culture
8. De plus, pour un croyant qui veut sincèrement entrer en dialogue avec la culture de son temps, ou simplement avec la vie des personnes concrètes, la littérature devient indispensable. À bon droit, le Concile Vatican II affirme que « la littérature et les arts […] s’efforcent d’exprimer la nature propre de l’homme » et « de mettre en lumière les misères et les joies, les besoins et les énergies ». [3] En vérité, la littérature s’inspire de la quotidienneté de la vie, de ses passions et de la réalité des événements tels que « l’action, le travail, l’amour, la mort et toutes les pauvres choses qui remplissent la vie ». [4]
9. Comment pouvons-nous atteindre le cœur des cultures anciennes et nouvelles si nous ignorons, rejetons et/ou réduisons au silence les symboles, messages, créations et récits avec lesquels ils ont saisi, et voulu dévoiler et évoquer, leurs entreprises et idéaux les plus beaux, ainsi que leurs violences, leurs peurs et leurs passions les plus profondes? Comment pouvons-nous parler au cœur des hommes si nous ignorons, reléguons et ne valorisons pas “ces mots” avec lesquels ils ont voulu manifester et, pourquoi pas révéler, le drame de leur vie et de leurs sentiments à travers des romans et des poèmes ?
10. La mission de l’Église a su déployer toute sa beauté, sa fraîcheur et sa nouveauté dans la rencontre avec les différentes cultures – souvent grâce à la littérature – dans lesquelles elle s’est enracinée, sans avoir peur de s’impliquer et d’en extraire le meilleur de ce qu’elle a trouvé. C’est une attitude qui l’a libérée de la tentation d’un solipsisme assourdissant et fondamentaliste qui consiste à croire qu’une certaine grammaire historico-culturelle a la capacité d’exprimer toute la richesse et la profondeur de l’Évangile. [5] Beaucoup de prophéties de malheur qui tentent de semer le désespoir aujourd’hui s’enracinent précisément dans cet aspect. Le contact avec des styles littéraires et grammaticaux divers permettra toujours d’approfondir la polyphonie de la Révélation sans l’appauvrir ou la réduire à des conditions historiques ou à des structures mentales.
11. Ce n’est donc pas un hasard si le christianisme des origines, par exemple, avait bien perçu la nécessité d’une confrontation étroite avec la culture classique de l’époque. Un Père de l’Église d’Orient comme Basile de Césarée, dans son Discours aux jeunes composé entre 370 et 375, probablement adressé à ses neveux, exaltait la valeur de la littérature classique – produite par les éxothen (“ceux de l’extérieur”), comme il appelait les auteurs païens – tant en raison de son argumentation, c’est-à-dire les lógoi (“discours”) à utiliser en théologie et en exégèse, qu’en raison de son témoignage de la vie, c’est-à-dire les práxeis (“les actes, les comportements”) à prendre en compte dans l’ascèse et la morale. Et il concluait en exhortant les jeunes chrétiens à considérer les classiques comme un ephódion (“viatique”) pour leur instruction et leur formation, en en tirant un « profit pour l’âme » (IV, 8-9). Et c’est précisément de cette rencontre de l’événement chrétien avec la culture de l’époque qu’est née une réélaboration originale de l’annonce de l’Évangile.
12. Grâce au discernement évangélique de la culture, il est possible de reconnaître la présence de l’Esprit dans la réalité humaine diversifiée, c’est-à-dire de saisir la semence déjà enfouie de la présence de l’Esprit dans les événements, dans les sensibilités, dans les désirs, dans les tensions profondes des cœurs et des contextes sociaux, culturels et spirituels. Nous pouvons, par exemple, reconnaître dans les Actes des Apôtres, lors de Paul à l’Aréopage (cf. Ac 17, 16-34), une approche de ce genre. Paul, parlant de Dieu, affirme : « C’est en lui que nous vivons, que nous nous mouvons, que nous existons, comme l’ont dit aussi certains de vos poètes : “Car nous sommes de sa descendance” ( Ac 17, 28). Il y a deux citations dans ce verset : une indirecte dans la première partie où est cité le poète Epiménide (6 ème siècle avant J.-C.), et une directe où est cité les Phénomènes du poète Aratus de Silo (3 ème siècle avant J.-C.) qui chante les constellations et les signes du beau et du mauvais temps. « Paul se révèle ici “lecteur” de poésie, et dévoile sa façon d’aborder le texte littéraire qui ne peut que faire réfléchir sur le discernement évangélique de la culture. Il est traité par les Athéniens de spermologos, c’est-à-dire de “corbeau, bavard, charlatan” mais, littéralement, de “récolteur de semences”. Ce qui était certainement une insulte devient paradoxalement une vérité profonde. Paul recueille les semences de la poésie païenne et, sortant d’une attitude antérieure de profonde indignation (cf. Ac 17, 16), il va jusqu’à reconnaître les Athéniens comme étant “très religieux” et voit dans ces pages de leur littérature classique une véritable preparatio evangelica ». [6]
13. Qu’a fait Paul ? Il a compris que la littérature « découvre les abîmes qui habitent l’homme, tandis que la révélation, puis la théologie, s’en emparent pour montrer comment le Christ vient les traverser et les illuminer ». [7] La littérature est donc une « voie d’accès », [8] vers ces abîmes, qui aide le pasteur à entrer dans un dialogue fructueux avec la culture de son temps.
Jamais de Christ sans chair
14. Avant d’approfondir les raisons spécifiques pour lesquelles l’attention à la littérature doit être encouragée dans le parcours de formation des futurs prêtres, permettez-moi de rappeler ici une réflexion sur le contexte religieux actuel : « Le retour au sacré et la recherche spirituelle qui caractérisent notre époque, sont des phénomènes ambigus. Mais, plus que l’athéisme, nous sommes aujourd’hui face au défi de répondre adéquatement à la soif de Dieu de beaucoup de personnes, afin qu’elles ne cherchent pas à l’assouvir dans des propositions aliénantes ou avec un Jésus Christ sans chair ». [9] La tâche urgente de l’annonce de l’Évangile à notre époque exige donc des croyants, et des prêtres en particulier, un engagement pour que chacun puisse rencontrer un Jésus-Christ fait chair, fait homme, fait histoire. Nous devons tous veiller à ne jamais perdre de vue la “chair” de Jésus-Christ : cette chair faite de passions, d’émotions, de sentiments, de récits concrets, de mains qui touchent et guérissent, de regards qui libèrent et encouragent, d’hospitalité, de pardon, d’indignation, de courage, d’intrépidité : en un mot, d’amour.
15. Et c’est précisément à ce niveau qu’une fréquentation assidue de la littérature peut rendre les futurs prêtres et tous les agents pastoraux encore plus sensibles à la pleine humanité du Seigneur Jésus, dans laquelle se répand pleinement sa divinité, et annoncer l’Évangile de manière à ce que tous, vraiment tous, puissent expérimenter combien est vrai ce que dit le Concile Vatican II : « En réalité, le mystère de l’homme ne s’éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné ». [10] Il ne s’agit pas du mystère d’une humanité abstraite, mais du mystère de cet être humain concret avec toutes les blessures, les désirs, les souvenirs et les espérances de sa vie.
Un grand bien
16. D’un point de vue pragmatique, de nombreux scientifiques affirment que l’habitude de lire produit de nombreux effets positifs dans la vie d’une personne : elle l’aide à acquérir un vocabulaire plus large et, par conséquent, à développer divers aspects de son intelligence. Elle stimule également l’imagination et la créativité. En même temps, elle lui permet d’apprendre à exprimer ses récits d’une manière plus riche. Elle améliore également sa capacité de concentration, réduit ses niveaux de déficience cognitive et calme le stress et l’anxiété.
17. Mieux encore, elle prépare à comprendre, et donc à faire face, aux différentes situations qui peuvent se présenter dans la vie. Dans la lecture, nous nous immergeons dans les personnages, les soucis, les drames, les dangers, les peurs de personnes qui ont fini par surmonter les défis de la vie, ou bien il se peut que, pendant la lecture, nous donnions aux personnages des conseils qui nous serviront plus tard.
18. Pour tenter d’encourager à nouveau à la lecture, je cite volontiers quelques textes d’auteurs très connus, qui nous apprennent beaucoup de choses en quelques mots :
Les romans libèrent « en nous, pendant une heure, tous les bonheurs et tous les malheurs possibles dont nous mettrions dans la vie des années à connaître quelques-uns, et dont les plus intenses ne nous seraient jamais révélés parce que la lenteur avec laquelle ils se produisent nous en ôte la perception ». [11]
« En lisant les grandes œuvres de la littérature, je deviens des milliers d’hommes et, en même temps, je reste moi-même. Comme le ciel nocturne de la poésie grecque, je vois avec une myriade d’yeux, mais c’est toujours moi qui vois. Ici, comme dans la religion, l’amour, l’action morale et le savoir, je me dépasse, et pourtant, lorsque je me dépasse, je suis plus moi-même que jamais ». [12]
19. Cependant, mon intention n’est pas de m’attarder uniquement sur ce niveau d’utilité personnelle, mais de réfléchir aux raisons les plus décisives pour éveiller l’amour de la lecture.
Écouter la voix de quelqu’un
20. Lorsque je pense à la littérature, je me souviens de ce que le grand écrivain argentin Jorge Luis Borges [13] disait à ses étudiants : le plus important est de lire, d’entrer en contact direct avec la littérature, de s’immerger dans le texte vivant qui se trouve devant nous, plutôt que de s’attacher aux idées et aux commentaires critiques. Et Borges expliquait cette idée à ses étudiants en leur disant qu’au début ils ne comprendraient peut-être pas grand-chose à ce qu’ils liraient ; mais, en tout cas, ils entendraient “la voix de quelqu’un”. C’est une définition de la littérature que j’aime beaucoup : écouter la voix de quelqu’un. Et n’oublions pas combien il est dangereux de ne plus écouter la voix de l’autre qui nous interpelle ! On tombe immédiatement dans l’auto-isolement, on entre dans une sorte de surdité “spirituelle” qui affecte aussi négativement notre relation avec nous-mêmes et notre relation avec Dieu, quelque soit la théologie ou la psychologie que nous avons pu étudier.
21. En parcourant cette voie qui nous rend sensibles au mystère des autres, la littérature nous apprend à toucher leur cœur. Comment ne pas rappeler ici la parole courageuse que, le 7 mai 1964, saint Paul VI adressa aux artistes et donc aussi aux grands écrivains ? Il disait : « Nous avons besoin de vous. Notre ministère a besoin de votre collaboration. Car, comme vous le savez, Notre ministère consiste à prêcher et à rendre accessible et compréhensible, voire émouvant, le monde de l’esprit, de l’invisible, de l’ineffable, de Dieu. Et dans cette opération qui transforme le monde invisible en formules accessibles et intelligibles vous êtes les maîtres ». [14] La tâche des croyants, et des prêtres en particulier, est précisément de “toucher” le cœur de l’homme contemporain pour qu’il s’émeuve et s’ouvre face à l’annonce du Seigneur Jésus, et, dans cet engagement, la contribution que la littérature et la poésie peuvent offrir est d’une valeur inestimable.
22. T.S. Eliot, le poète à qui l’esprit chrétien doit des œuvres littéraires qui ont marqué le monde contemporain, a décrit à juste titre la crise religieuse moderne comme celle d’une « incapacité émotionnelle » [15] généralisée. À la lumière de cette lecture de la réalité, le problème de la foi aujourd’hui n’est pas avant tout de croire plus ou moins aux propositions doctrinales. Il s’agit plutôt de l’incapacité de nombre de personnes de s’émouvoir devant Dieu, devant sa création, devant les autres êtres humains. La tâche est donc de guérir et d’enrichir notre sensibilité. C’est pourquoi, à mon retour du Voyage Apostolique au Japon, lorsqu’on m’a demandé ce que l’Occident avait à apprendre de l’Orient, j’ai répondu : « Je crois qu’il manque un peu de poésie à l’Occident ». [16]
Une sorte de gymnase du discernement
23. Que gagne donc le prêtre à ce contact avec la littérature ? Pourquoi est-il nécessaire de considérer et de promouvoir la lecture de grands romans comme une composante importante de la paideia sacerdotale ? Pourquoi est-il important de retrouver et de mettre en œuvre dans la formation des candidats au sacerdoce l’intuition, esquissée par le théologien Karl Rahner, d’une profonde affinité spirituelle entre le prêtre et le poète ? [17]
24. Essayons de répondre à ces questions en écoutant les considérations du théologien allemand. [18] Les paroles du poète, écrit Rahner, sont « pleines de nostalgie », elle sont « des portes qui s’ouvrent sur l’infini, des portes qui s’ouvrent largement sur l’immensité. Elles évoquent l’ineffable, elles tendent vers l’ineffable ». Cette parole poétique « donne sur l’infini, mais elle ne peut pas nous donner cet infini, ni porter ou cacher en elle Celui qui est l’Infini ». Cela, c’est le propre de la Parole de Dieu, et – poursuit Rahner – « la parole poétique invoque la parole de Dieu ». [19] Pour les chrétiens, la Parole est Dieu, et toutes les paroles humaines, portent la trace d’une nostalgie intrinsèque de Dieu tendant vers cette Parole. On peut dire que la parole véritablement poétique participe analogiquement à la Parole de Dieu telle que la Lettre aux Hébreux nous la présente de manière bouleversante (cf. He 4, 12-13).
25. Et c’est ainsi que Karl Rahner peut établir un beau parallèle entre le prêtre et le poète : « Seule la parole est intimement capable de libérer de ce qui tient en captivité toutes les réalités inexprimées : le mutisme de leur tendance vers Dieu ». [20]
26. Ensuite, dans la littérature, ce sont des questions de forme d’expression et de sens qui sont en jeu. Elle représente donc une sorte de gymnase de discernement qui aiguise les capacités sapientielles d’examen intérieur et extérieur du futur prêtre. Le lieu où s’ouvre cette voie d’accès à sa propre vérité est l’intériorité du lecteur directement impliqué dans le processus de lecture. Voici donc le déploiement du scénario du discernement spirituel personnel où se trouvent les angoisses et même les crises. En effet, nombreuses sont les pages littéraires qui peuvent répondre à la définition ignatienne de la “désolation”.
27. « J’appelle désolation […] les obscurités de l’âme, trouble en elle, motion vers les choses basses et terrestres, absence de paix venant de diverses agitations et tentations qui poussent à un manque de confiance sans espérance, sans amour, l’âme se trouvant toute paresseuse, tiède, triste et comme séparée de son Créateur et Seigneur ». [21]
28. La douleur ou l’ennui que l’on ressent en lisant certains textes ne sont pas nécessairement des sentiments mauvais ou inutiles. Ignace de Loyola lui-même avait noté que chez « ceux qui vont de mal en pis », le bon esprit agit en provoquant l’inquiétude, l’agitation, l’insatisfaction. [22] C’est l’application littérale de la première règle ignatienne du discernement des esprits, réservée à ceux qui « vont de péché mortel en péché mortel » et qui veut que, chez ces personnes, le bon esprit « les aiguillonne et morde leur conscience par le sens moral – la syndérèse – de la raison » [23] pour les amener au bien et à la beauté.
29. On comprend ainsi que le lecteur n’est pas le destinataire d’un message édifiant, mais qu’il est une personne activement sollicitée à s’aventurer sur un terrain instable où les frontières entre le salut et la perdition ne sont pas a priori définies et séparées. L’acte de lecture s’apparente donc à un acte de “discernement” par lequel le lecteur est impliqué personnellement en tant que “sujet” de la lecture et en même temps “objet” de ce qu’il lit. En lisant un roman ou une œuvre poétique, le lecteur vit l’expérience d’“être lu” par les mots qu’il lit. [24] Le lecteur est ainsi semblable à un joueur sur le terrain : il joue le jeu, mais en même temps le jeu se fait à travers lui, en ce sens qu’il est totalement impliqué dans ce qu’il fait. [25]
Attention e digestion
30. En ce qui concerne les contenus, il faut reconnaître que la littérature est comme “un télescope” – selon la célèbre image inventée par Proust [26] – braqué sur les êtres et les choses, indispensable pour mettre en évidence “la grande distance” que le quotidien creuse entre notre perception et la totalité de l’expérience humaine. « La littérature est comme un laboratoire photographique dans lequel les images de la vie peuvent être traitées pour en révéler les contours et les nuances. C’est donc à cela que “sert” la littérature : à “développer” les images de la vie », [27] à nous interroger sur son sens. Elle sert, en somme, à faire efficacement expérience de la vie.
31. En vérité, notre vision ordinaire du monde est comme “réduite” et limitée à cause de la pression qu’exercent sur nous les objectifs opérationnels et immédiats de notre agir. Même le service – cultuel, pastoral, caritatif – peut devenir un impératif qui oriente nos forces et notre attention uniquement vers les objectifs à atteindre. Mais, comme le rappelle Jésus dans la parabole du semeur, la semence a besoin de tomber dans une terre profonde pour mûrir avec fécondité dans le temps sans être étouffée par la superficialité ou les épines (Mt 13, 18-23). Autrement le risque devient celui de tomber dans une efficacité qui banalise le discernement, appauvrit la sensibilité et réduit la complexité. Il est donc nécessaire et urgent de contrebalancer cette accélération et cette simplification inévitables de notre vie quotidienne en apprenant à prendre de la distance par rapport à l’immédiat, à ralentir, à contempler et à écouter. Cela peut se produire lorsqu’une personne s’arrête librement pour lire un livre.
32. Il est nécessaire de retrouver des manières de se comporter face aux réalités accueillantes, non stratégiques, non directement finalisées à un résultat, où il est possible de laisser émerger l’infinie démesure de l’être. Distance, lenteur, liberté sont les caractéristiques d’une approche du réel trouvant précisément dans la littérature une forme d’expression qui n’est certes pas exclusive mais privilégiée. La littérature devient alors un gymnase où l’on entraîne le regard à chercher et à explorer la vérité des personnes et des situations en tant que mystère, en tant que chargées d’un excès de sens qui ne peut se manifester que partiellement dans des catégories et des schémas explicatifs, dans des dynamiques linéaires de cause à effet, de moyen à fin.
33. Une autre belle image pour dire le rôle de la littérature vient de la physiologie du corps humain et en particulier de l’acte de digestion. Ici, son modèle est la ruminatio de la vache, comme l’affirmaient le moine Guillaume de Saint-Thierry au XI ème siècle et le jésuite Jean-Joseph Surin au XVII ème siècle. Ce dernier parle de “l’estomac de l’âme” et le jésuite Michel De Certeau a évoqué une véritable “physiologie de la lecture digestive”. [28] La littérature nous aide à dire notre présence au monde, à la “digérer” et à l’assimiler en saisissant ce qui va au-delà de la surface du vécu ; elle sert donc à interpréter la vie en discernant ses significations et tensions fondamentales. [29]
Voir à travers les yeux des autres
34. En ce qui concerne la forme du discours, voici ce qui se passe : la lecture d’un texte littéraire nous met en position de « voir à travers les yeux des autres » [30] en acquérant une largeur de perspective qui élargit notre humanité. Elle active en nous le pouvoir empathique de l’imagination qui est un véhicule fondamental pour la capacité d’identification au point de vue, à la condition, aux sentiments des autres, sans laquelle il n’y a pas de solidarité, de partage, de compassion, de miséricorde. En lisant, nous découvrons que ce que nous ressentons n’est pas seulement nôtre mais universel, de sorte que même la personne la plus abandonnée ne se sent pas seule.
35. La merveilleuse diversité de l’être humain et la pluralité diachronique et synchronique des cultures et des savoirs sont configurées dans la littérature en un langage capable d’en respecter et d’en exprimer la variété. Elles sont en même temps traduites dans une grammaire symbolique du sens qui nous les rend intelligibles, non pas étrangères, mais partagées. L’originalité de la parole littéraire réside dans le fait qu’elle exprime et transmet la richesse de l’expérience non pas en l’objectivant dans la représentation descriptive du savoir analytique ou dans l’examen normatif du jugement critique, mais comme contenu d’un effort expressif et interprétatif donnant un sens à l’expérience en question.
36. Lorsque nous lisons une histoire, grâce à la vision de l’auteur chacun imagine à sa manière les pleurs d’une fille abandonnée, la personne âgée couvrant le corps de son petit-fils endormi, la passion du petit entrepreneur essayant de s’en sortir malgré les difficultés, l’humiliation de celui qui se sent critiqué par tout le monde, le garçon qui rêve comme seul moyen d’échapper à la souffrance d’une vie misérable et violente. Alors que nous ressentons des traces de notre monde intérieur au milieu de ces histoires, nous devenons plus sensibles aux expériences des autres, nous sortons de nous-mêmes pour entrer dans leurs profondeurs, nous pouvons comprendre un peu mieux leurs efforts et leurs désirs, nous voyons la réalité à travers leurs yeux et, en fin de compte, nous devenons des compagnons de route. Nous nous immergeons ainsi dans l’existence concrète et intérieure du vendeur de fruits, de la prostituée, de l’enfant qui grandit sans ses parents, de la femme du maçon, de la vieille femme qui croit encore qu’elle trouvera son prince. Et nous pouvons le faire avec empathie et parfois avec tolérance et compréhension.
37. Jean Cocteau écrivait à Jacques Maritain : « La littérature est impossible, il faut en sortir, et il est inutile d’essayer de s’échapper par la littérature, car seuls l’amour et la foi nous permettent de sortir de nous-mêmes ». [31] Mais sortons-nous vraiment de nous-mêmes si les souffrances et les joies des autres ne brûlent pas dans nos cœurs ? Je préfère me rappeler qu’en tant que chrétien, rien de ce qui est humain ne m’est indifférent.
38. En outre, la littérature n’est pas relativiste parce qu’elle ne nous dépouille pas de critères de valeur. La représentation symbolique du bien et du mal, du vrai et du faux, comme dimensions qui prennent dans la littérature la forme d’existences individuelles et d’événements historiques collectifs, ne neutralise pas le jugement moral mais l’empêche de devenir aveugle ou de condamner superficiellement. Jésus nous demande : « Qu’as-tu à regarder la paille qui est dans l’œil de ton frère ? Et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ! » (Mt 7, 3).
39. Et dans la violence, faiblesse ou fragilité des autres, nous avons l’occasion de mieux réfléchir sur la nôtre. En ouvrant au lecteur une large vision de la richesse et de la misère de l’expérience humaine, la littérature éduque son regard à la lenteur de la compréhension, à l’humilité de la non-simplification, à la mansuétude de ne pas prétendre maîtriser la réalité et la condition humaine par le jugement. Le jugement est certes nécessaire, mais il ne faut jamais oublier sa portée limitée : jamais, en effet, le jugement ne doit se traduire par une condamnation à mort, par un effacement, par une suppression de l’humanité au profit d’une aride totalisation de la loi.
40. Le regard de la littérature forme le lecteur au décentrement, au sens de la limite, au renoncement à la domination cognitive et critique sur l’expérience, lui apprenant une pauvreté qui est source d’une extraordinaire richesse. En reconnaissant l’inutilité et peut-être même l’impossibilité de réduire le mystère du monde et de l’être humain à une polarité antinomique vrai/faux, ou juste/injuste, le lecteur accepte le devoir de juger non pas comme un instrument de domination mais comme un élan vers une écoute incessante et comme une disponibilité à s’impliquer dans cette extraordinaire richesse de l’histoire due à la présence de l’Esprit qui se donne aussi comme Grâce : c’est-à-dire comme un événement imprévisible et incompréhensible qui ne dépend pas de l’action humaine, mais qui redéfinit l’humain comme espérance de salut.
La puissance spirituelle de la littérature
41. J’espère avoir mis en évidence, dans ces brèves réflexions, le rôle que la littérature peut jouer dans l’éducation du cœur et de l’esprit du pasteur ou du futur pasteur, dans le sens d’un exercice libre et humble de sa rationalité, d’une reconnaissance fructueuse du pluralisme des langages humains, d’un élargissement de sa sensibilité humaine et, enfin, d’une large ouverture spirituelle à l’écoute de la Voix à travers de nombreuses voix.
42. En ce sens, la littérature aide le lecteur à briser les idoles des langages autoréférentiels faussement autosuffisants, statiquement conventionnels, qui risquent parfois de polluer même notre discours ecclésial en emprisonnant la liberté de la Parole. La parole littéraire est celle qui met en mouvement, libère et purifie le langage : elle l’ouvre enfin à d’autres possibilités d’expression et d’exploration, elle le rend accueillant à la Parole qui s’installe dans le langage humain, non pas lorsqu’il se comprend comme un savoir déjà plénier, définitif et complet, mais lorsqu’il devient une veille d’écoute en attente de Celui qui vient faire toutes choses nouvelles (cf. Ap 21, 5).
43. Le pouvoir spirituel de la littérature rappelle en définitive la tâche première confiée par Dieu à l’homme : celle de “nommer” les êtres et les choses (cf. Gn 2, 19-20). La mission de gardien de la création, assignée par Dieu à Adam, passe avant tout par la reconnaissance de sa propre réalité et du sens de l’existence des autres êtres. Le prêtre est lui aussi investi de cette tâche originelle de “nommer”, de donner du sens, de se faire instrument de communion entre la création et la Parole faite chair avec son pouvoir d’illuminer tous les aspects de la condition humaine.
44. L’affinité entre le prêtre et le poète se manifeste donc dans cette union sacramentelle mystérieuse et indissoluble entre la Parole divine et la parole humaine, donnant lieu à un ministère qui devient un service rempli d’écoute et de compassion, à un charisme qui devient responsabilité, à une vision du vrai et du bien qui éclot comme beauté. Nous ne pouvons qu’entendre les paroles que nous a laissées le poète Paul Celan : « Celui qui apprend vraiment à voir s’approche de l’invisible ». [32]
Donné à Rome, près de Saint-Jean-du-Latran, le 17 juillet 2024, en la douzième année de mon Pontificat.
FRANÇOIS
[1] R. Latourelle, Letteratura, in R. Latourelle – R. Fisichella, Dizionario di Teologia Fondamentale, Assisi (PG) 1990, p. 631.
[2] Cf. A. Spadaro, «J. M. Bergoglio, il “maestrillo” creativo. Intervista all’alunno Jorge Milia», in La Civiltà Cattolica 2014 I, pp. 523-534.
[3] Conc. Œcum. Vat. II, Gaudium et spes, n. 62.
[4] K. Rahner, «Il futuro del libro religioso», in Nuovi saggi II, Roma 1968, p. 647.
[5] Cf. Exhort. ap. Evangelii Gaudium, n. 6.
[6] A. Spadaro, Svolta di respiro. Spiritualità della vita contemporanea, Milano, Vita e Pensiero, p. 101.
[7] R. Latourelle, «Letteratura», p. 633.
[8] S. Jean-Paul II, Lettre aux artistes, 4 avril 1999, n. 6.
[9] Exhort. Ap. Evangelii Gaudium, n. 89.
[10] Const. past. Gaudium et spes, n. 22 § 1.
[11] M. Proust, À la recherche du temps perdu – Du côté de chez Swann, B. Grasset, Paris 1914, pp. 104-105.
[12] C.S. Lewis, Lettori e letture. Un esperimento di critica, Milano 1997, 165 .
[13] Cf. Borges, Oral, Buenos Aires 1979.
[14] Homélie, « Messe des Artistes », 7 mai 1964.
[15] The Idea of a Christian Society, London 1946, p. 30.
[16] Conférence de presse du Saint Père au cours du vol du retour du Voyage apostolique en Thaïlande et au Japon, 26 novembre 2019.
[17] Cf. A. Spadaro, La grazia della parola. Karl Rahner e la poesia, Milano, Jaca Book, 2006.
[18] Cf. K. Rahner, «Sacerdote e poeta», in La Fede in mezzo al mondo, Alba 1963, pp. 131-173.
[19] Ibid., p. 171 s.
[20] Ibid., p. 146.
[21] S. Ignace de Loyola, Exercices Spirituelles, n. 317.
[22] Cf. ibid., n. 335.
[23] ibid., n. 314.
[24] Cf. K. Rahner, «Sacerdote e poeta» in La fede in mezzo al mondo, Alba 1963, p. 141.
[25] Cf. A. Spadaro, La pagina che illumina. Scrittura creativa come esercizio spirituale, Milano, Ares, 2023, pp. 46-47.
[26] Cf. M. Proust, À la recherche du temps perdu. Le temps retrouvé, Paris 1954, Vol. III, p. 1041.
[27] A. Spadaro, La pagina che illumina, op. cit., p. 14
[28] M. de Certeau, Il parlare angelico. Figure per una poetica della lingua (Secoli XVI e XVII), Firenze 1989, p. 139.
[29] Cf. A. Spadaro, La pagina che illumina, op. cit., p. 16.
[30] C.S. Lewis, Lettori e letture. Un esperimento di critica, Milano 1997, p. 165.
[31] J. Cocteau – J. Maritain, dialogue sur la foi, Firenze, Passigli 1988, p. 56. Cf. A. Spadaro, La pagina che illumina, op. cit., p. 11-12.
[32] Microliti, Milano 2020, p. 101.





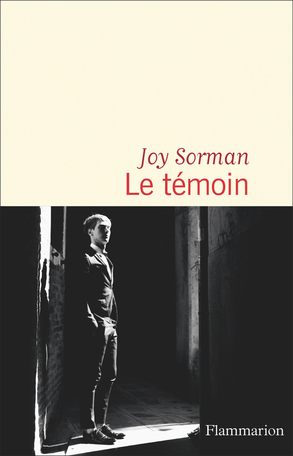

:quality(50)/2023/09/08/amoudi-mokhtar-couv-avec-bandeau-les-conditions-ideales-64fb0813eeb3c471743287.jpg)