
Erri De Luca, Le plus et le moins, Gallimard, Paris 2016
Texte qui date de 2015, Le plus et le moins n’est pas d’un abord facile. Du moins le temps des premières pages. On ne sait pas à quoi l’on a affaire, des petits chapitres de quelques pages qui présentent des sensations plus que des anecdotes. On comprend peu à peu qu’il s’agit de souvenirs, comme des pages détachées d’une éphéméride, rassemblés, sans lien entre eux, si ce n’est qu’ils finissent par dessiner le monde de l’auteur, sa manière de vivre le monde.
La beauté de la prose, la force des images, le surréalisme qui transmue le réel tiennent le lecteur en suspens plus qu’une narration. « J’ai touché l’immense en peu d’espace, l’épuisement du corps et l’énergie absorbée par un fruit cru de mer. J’étais une chose de la nature exposée à la saison. Je donnais le nom de l’île à cette liberté. »
C’est le fils accompagnant sa mère âgée renouveler ce qu’elle sait être sa dernière carte d’identité. Il est incapable de dire quoi que ce soit quand elle dit sa fin, sa mort mais prend le plus grand soin du corps qui peine dans l’escalier du bureau de l’Etat civil. « A présent, elle fait aussi partie de l’histoire. Dans ma cuisine, le soir, assis à notre table déserte, je mâche mon dîner les yeux dans mon assiette et j’avale les manques dont je suis composé. »
C’est la littérature, la lecture. « Les livres ne redoublent pas l’épaisseur des murs, ils l’annulent au contraire. A travers les pages, on voit dehors. »
C’est la force de la révolte, celle qui refuse l’injustice et le mépris. C’est l’anarchie comme dénonciation de tous les pouvoirs. « « Vos fils et vos filles sont au-delà de vos ordres » : ce n’était pas un cri, c’était un crachat sur les pieds des hiérarchies, un graillon contre l’arbre de la transmission de pouvoir et de soumission d’une génération à l’autre. » « Là où la guerre est la loi, les actes de la paix sont clandestins, des actes de bandits. » Tous ceux qui aident les migrants le savent alors que le ministre vend le pays au diable de la haine des ignorés.
C’est la rencontre amoureuse qui troue l’absence, interdit la suffisance retirée du vieux garçon. « La femme était un bout de soir de fin de décembre, entrée par la porte en même temps que le vent. […] Elle a ri entre mes bras, le sursaut le plus beau qu’un homme puisse contenir. »
Les moments ainsi juxtaposés n’ont plus grand-chose d’autobiographique ; ils ne sont plus rien de circonstanciel ni d’individuel. Ou plutôt, leur singularité donne au texte une forme d’universalité, rien d’abstrait, mais ce qu’effectivement ceux de l’humanité ont en partage, voudraient avoir à se raconter, tant comme ce qu’ils savent que ce qu’ils ont besoin d’apprendre.
On termine la lecture, comme si c’était un art de la simplicité que la vie, et que c’est tellement difficile la simplicité. Non le simplisme, les p’tites jolies choses, la première gorgée de bière, etc. mais le rire aux éclats de l’enfant nietzschéen. Lecteur des Ecritures, Erri De Luca est si souvent le commentateur de la pauvreté de cœur évangélique, une porte étroite, un joug qu’il faut du temps à découvrir léger, la vie en abondance dans la frugalité. Du journal d’un aveugle, réécriture d’une guérison par Jésus, passe comme l’évangile du miracle à la croix. « Hélas, homme, tu as ouvert les yeux à tant d’entre nous et personne ne pourra fermer les tiens quand tu les ouvriras tout grands et aveugles sur l’échafaud des Romains. Ils le suspendirent à la poutre les bras écartés. Je suis resté jusqu’à son dernier souffle. « Dans ta main, confie mon vent », cria-t-il en citant les vers du psaume de David. Soudain, il fit nuit en plein jour, un goudron d’obscurité sur Jérusalem. Seuls, nous autres les aveugles, trouvâmes le chemin du retour sans obstacle. »







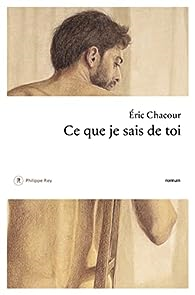

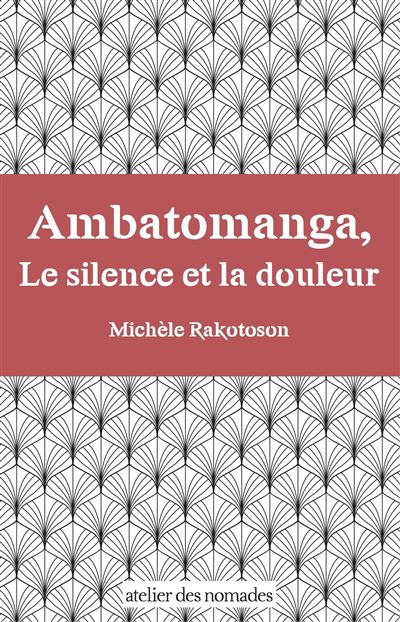 Atelier des nomades, 2022
Atelier des nomades, 2022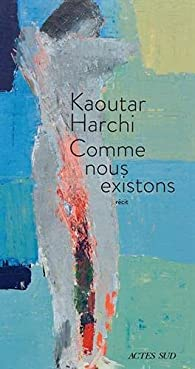 Actes Sud, Arles 2021
Actes Sud, Arles 2021
