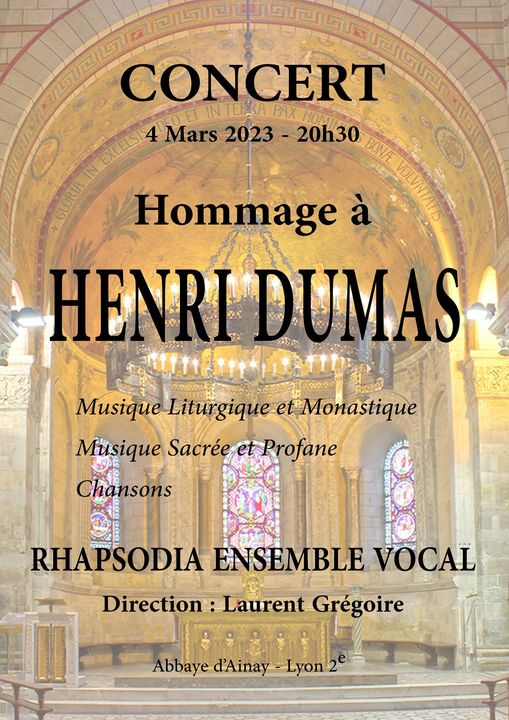Tahar Ben Jelloun, Au plus beau pays du monde, Seuil, Paris 2022
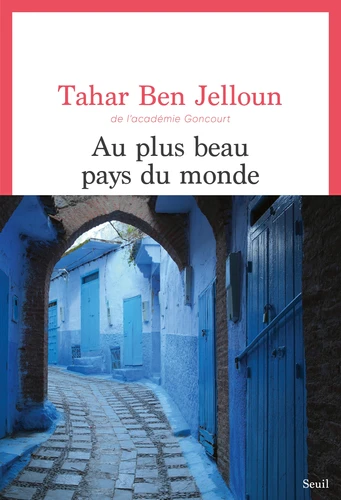
Une série de quatorze nouvelles (publiée en octobre 2022) comme autant de micro-observations de la société marocaine contemporaine, surtout celle d’une classe sociale aisée, souvent installée entre le Maghreb et l’Europe. Des miniatures pleines de tendresses ou porteuses d’une violence terrible. Le déchirement d’une identité entre un pays dont on n’est pas ou plus et un autre dont on ne sera jamais totalement, soit que le racisme l’empêche, soit que la nostalgie d’un art de vivre l’interdise.
Au plus beau pays du monde dit l’exagération nostalgique au point que l’on ne sait s’il faut entendre le titre comme la joie et la fierté d’avoir la chance d’être de ce pays ou l’ironie qui dénonce le mensonge de ce que l’on serait obligé de dire à propos de son pays. Selon que vous lisez telle nouvelle plutôt que l’autre, selon que vous êtes sensible à la beauté d’une civilisation ou agressé par la force du destin ‑ Mektoub, c’est écrit ‑ vous oscillez d’une interprétation. Le titre du recueil, contrairement à ce qui arrive souvent, n’est pas celui d’une des nouvelles mais celui du poème qui ouvre le volume. Pas sûr qu’il permettre de trancher sur ce que l’auteur pense lui-même du plus beau pays.
La langue est belle, poétique. Cela ne fait qu’en rajouter au déchirement. Comment dire la méchanceté et la cruauté bellement ? N’est-ce pas déjà les civiliser, les policer, les amoindrir ?
La première nouvelle se joue dans la dernière ligne. C’est magnifique. Mais là encore, les interprétations sont ouvertes, rien n’est dicté. Non, ce n’est pas écrit, et c’est sans doute cela qui permet de dire, au premier degré, que l’on est au plus beau pays du monde.


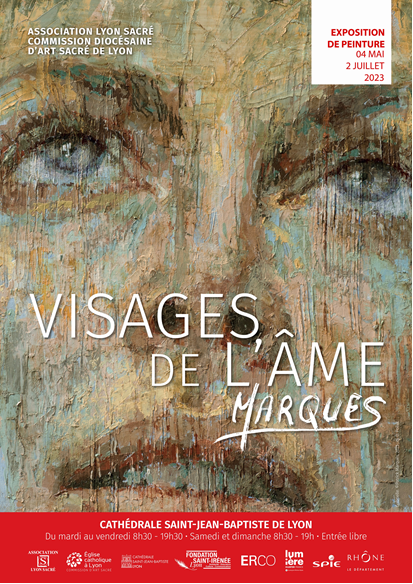

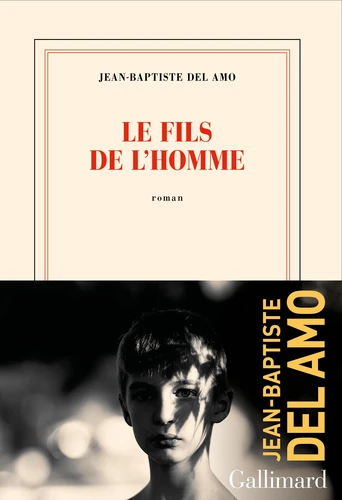
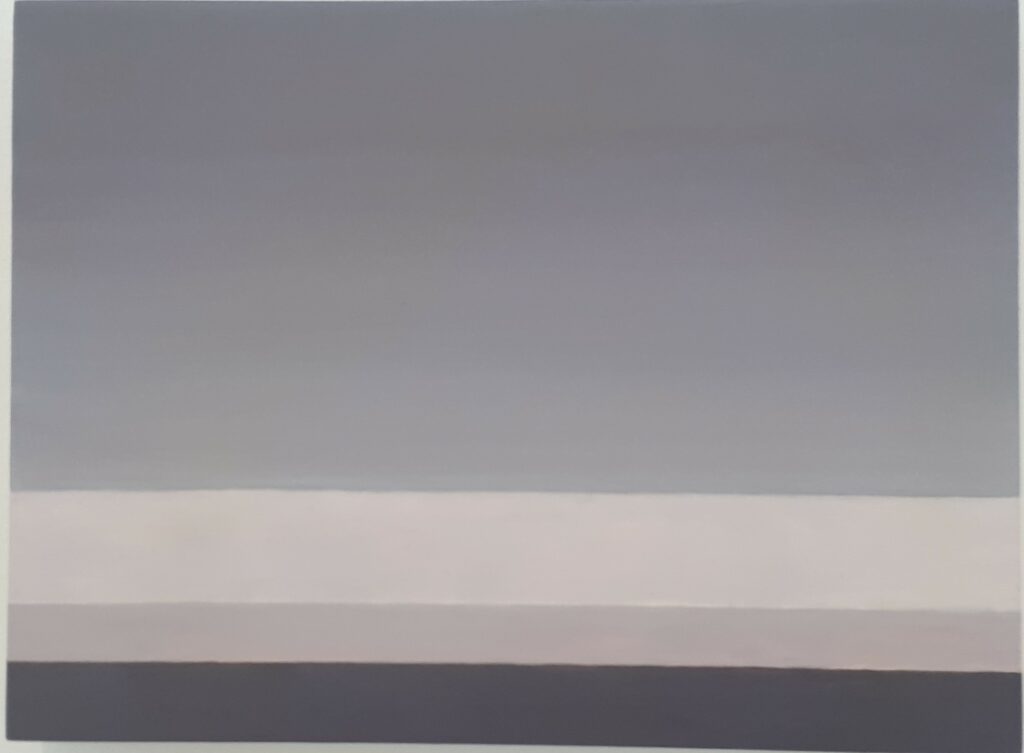
/image%2F1338740%2F20230210%2Fob_bd77a6_bolla.jpg)